Les prochains stages/events
Forum des associations de Quimper 2024
Samedi 7 septembre 2024
de 9h à 18h, ouvert à tous
L'Aïkido Quimper sera présent pour vous accueillir sur son stand pour des infos ou pour s'inscrire.
Rentrée saison 2024-2025 de l'Aïkido Quimper
Mardi 10 septembre 2025
de 19h à 21h, ouvert à tous
Deux cours d'essais gratuits sont proposés.
Calendriers des stages 2024 2025
Les calendriers des stages de la ligue de Bretagne et du département sont disponibles sur la page Cours, onglet Calendrier.
Stage d'armes à l'Aïkido Quimper
Dimanche 28 avril 2024
de 9h30 à12h et de 14h à 16h30
Animé par Claude Jacob, 5ème dan
Ouvert à tous
Dojo Sanshiro, 10 avenue de Kéradennec - 29000 Quimper
Les articles
Shu Ha Ri
en Aïkido
en Aïkido
En fait, si on s’étonne, c’est qu’on ne comprend plus l’essentiel : c’est qu’un enseignement doit nécessairement nous faire sortir du sillage, non pas en quittant la voie du maître, mais en la renouvelant pour soi-même.
L’aboutissement d’un enseignement, c’est sa « refonte » par celui qui en a été le bénéficiaire. C’est une pensée universelle, un art de transmettre si partagé par les traditions anciennes, qu’il fait peut-être partie de la grande tradition originelle si elle existe.
C’est un modèle qui remonte à loin, une compréhension ancienne de la méthode pour s’accomplir dans une expertise et à travers elle, comme homme.
Signification de Shu ha ri
Shu Ha Ri est un terme utilisé par les Japonais pour décrire la progression globale de l’entraînement aux arts martiaux, ainsi que la relation à vie que l’étudiant entretiendra avec son instructeur.
Shu peut signifier « protéger » ou « obéir ». Le double sens du terme décrit bien la relation entre un étudiant en arts martiaux et un enseignant dans les premiers stades de l’élève, qui peut être comparée à la relation d’un parent et d’un enfant.
L’étudiant doit absorber tout ce que l’enseignant lui transmet, être désireux d’apprendre et prêt à accepter toutes les corrections et les critiques constructives.
L’enseignant doit protéger l’élève en ce sens qu’il veille à ses intérêts et qu’il nourrit et encourage ses progrès, tout comme un parent protège un enfant tout au long de sa croissance.
Shu met l’accent sur les bases d’une manière intransigeante afin que l’élève ait une base solide pour l’apprentissage futur, et que tous les élèves exécutent les techniques de manière identique, même si leur personnalité, leur structure corporelle, leur âge et leurs capacités diffèrent tous.
Ha est un autre terme avec un double sens approprié : « se libérer » ou « frustrer ».
Quelque temps après que l’élève ait atteint le niveau dan (ceinture noire), il ou elle commencera à se libérer de deux manières.
En termes de technique, l’étudiant se libérera des fondamentaux et commencera à appliquer les principes acquis par la pratique des bases de manière nouvelle, plus libre et plus imaginative.
L’individualité de l’élève commencera à émerger dans la façon dont il ou elle exécute les techniques. À un niveau plus profond, il ou elle se libérera également de l’enseignement rigide de l’enseignant et commencera à questionner et à découvrir davantage par l’expérience personnelle.
Cela peut être une période de frustration pour l’enseignant, car le voyage de découverte de l’élève conduit à d’innombrables questions commençant par « Pourquoi...
Au stade Ha, la relation entre l’élève et l’enseignant est semblable à celle d’un parent et d’un enfant adulte ; L’enseignant est un maître de l’art, et l’élève peut maintenant être un instructeur pour les autres.
Ri est l’étape à laquelle l’élève, maintenant kodansha (ceinture noire de haut rang), se sépare de l’instructeur après avoir absorbé tout ce qu’il ou elle peut apprendre d’eux.
Cela ne veut pas dire que l’élève et l’enseignant ne sont plus associés.
En fait, c’est tout le contraire qui devrait être vrai ; Ils devraient maintenant avoir un lien plus fort que jamais, un peu comme un grand-parent le fait avec son fils ou sa fille qui est maintenant aussi un parent.
Bien que l’étudiant soit maintenant totalement indépendant, il chérit la sagesse et les conseils patients de l’enseignant et il y a une richesse dans leur relation qui découle de leurs expériences partagées.
Mais l’élève apprend et progresse maintenant plus par la découverte de soi que par l’enseignement et peut donner libre cours à ses propres impulsions créatrices.
Les techniques de l’élève porteront l’empreinte de sa propre personnalité et de son caractère.
Ri, lui aussi, a un double sens, dont la deuxième partie est « libérer » Autant l’étudiant cherche maintenant l’indépendance vis-à-vis de l’enseignant, autant l’instructeur doit libérer l’élève.
Shu Ha Ri n’est pas une progression linéaire. Il s’apparente plus à des cercles concentriques, de sorte qu’il y a Shu à l’intérieur de Ha et à la fois Shu et Ha à l’intérieur de Ri.
Ainsi, les fondamentaux restent constants ; Seules leur application et les subtilités de leur exécution changent au fur et à mesure que l’étudiant progresse et que sa propre personnalité commence à parfumer les techniques exécutées.
De même, l’élève et l’enseignant sont toujours liés par leur relation étroite et par les connaissances, l’expérience, la culture et la tradition qu’ils partagent.
En fin de compte, Shu Ha Ri devrait permettre à l’étudiant de surpasser le maître, à la fois en connaissances et en compétences.
C’est la source d’amélioration pour l’art dans son ensemble. Si l’élève ne surpasse jamais son maître, alors l’art stagnera, au mieux. Si l’étudiant n’atteint jamais la capacité du maître, l’art se détériorera.
Mais, si l’étudiant peut assimiler tout ce que le maître peut transmettre et ensuite progresser à des niveaux d’avancement encore plus élevés, l’art s’améliorera et s’épanouira continuellement.

"Shu ha ri s’applique à toutes les techniques traditionnelles, que ce soit dans le Chado, la voie du thé, du Kado, l’arrangement floral, etc...
Toutes ces voies s’étudient ainsi et passent par ces étapes.
Shu est l’étape où l’on suit scrupuleusement l’enseignement de son maître jusqu’à arriver à reproduire exactement les techniques. Une fois arrivé à ce niveau on essaye de voir ce que tel ou tel changement implique. On sort du moule pour continuer son étude. C’est Ha.
Finalement on dépasse les contradictions et la technique devient sienne. C’est Ri."
Shu ha ri, par Suga senseï
"Shu, ha et ri sont trois étapes qui sont suivis par les voies traditionnelles japonaises classiques.
En simplifiant on peut dire que shu correspond à l'intégration, c'est une période où l'élève travaille dans une imitation totale de son maître.
Ha est la période "destructrice". L'élève travaille dans des directions parfois opposées à celle de son maître et fais le maximum d'expériences possibles afin de s'approprier ce qu'il a reçu dans l'étape précédente.
Finalement le dernier stade, ri, est l'expression véritable de l'art que l'élève, devenu maître à son tour, a développé. Il est au-delà de la dualité et ne cherche ni à imiter ni à se différencier. Il est devenu son art et l'art s'exprime spontanément à travers lui. C'est l'état qu'a atteint aujourd'hui Tamura senseï dans sa pratique de l'Aïkido."
Shu ha ri, par Léo Tamaki
"Shu ha ri représente aussi symboliquement le passage de l'enfance à l'âge adulte.
L'étape shu correspond à l'enfance. On copie. On essaye de faire comme papa maman. L'étape ha correspond à l'adolescence. On veut faire différemment. On veut vivre ses propres expériences. Ri, enfin, est l'âge adulte. On n'essaye plus de copier ou faire le contraire de ses parents. Nos actes ne sont plus supposés être en réaction.
Bien entendu être sorti de l'adolescence ne signifie pas que l'on sache tout. Et chaque instant de notre vie peut, jusqu'au dernier, être source d'évolution.
Notez en outre que shu ha ri est un processus riche qui comporte de nombreux enseignements, et d'autres niveaux de lecture."
"Le processus d'enseignement des Budos se caractérise par les étapes shu, ha et ri.
En simplifiant, shu est l'étape de l'imitation. C'est une période durant laquelle l'élève doit imiter le maître. L'essentiel est de reproduire de façon aussi fidèle que possible ce qu'il réalise. C'est une étape frustrante, qui ne laisse pas de place à l'interprétation. Mais elle permettra à l'adepte de découvrir les principes et stratégies de la discipline, et surtout l'obligera à s'oublier soi-même en mettant de côté ses préférences et réflexes naturels.
Les uchi-deshis personnifient parfaitement cette période. Si l'on considère que les élèves d'Osenseï s'entraînaient une moyenne de trois heures quotidiennes, et que nombre d'entre eux partaient enseigner après quelques années, on peut prendre le chiffre de 5 000 heures comme indicatif de la durée MINIMALE de la période de shu. Pour des pratiquants "moyens" qui s'entraînent deux fois une heure et demie par semaine hors vacances scolaires et font quelques stages, cette période durerait donc… vingt à trente ans. La période ha est celle de l'exploration.
L'adepte est alors capable de reproduire fidèlement et avec une certaine efficacité les formes qu'il a étudiées. Etant souvent devenu enseignant, il commence à expérimenter les possibilités que peuvent offrir des variations, et même des changements importants dans ce qu'il a appris.
Me considérant à cette étape, je n'ai aucune idée de sa durée moyenne, mais je crois qu'on peut imaginer sans grands risques qu'elle prend AU MINIMUM autant de temps, c'est à dire 5 000 heures. C'est une étape que connaîtront peu de pratiquants.
Et c'est enfin ri, la période de la maîtrise. À ce stade l'adepte n'agit plus en réaction à l'enseignement qu'il a reçu, ne cherchant ni à le copier, ni à s'en écarter. Sa pratique pourra être proche, comme très différente de celle de son maître. Elle sera dans tous les cas une incarnation libre et légitime de la discipline. Rares sont naturellement les adeptes qui atteignent ce stade.
Si métaphoriquement la période shu correspond à l'enfance où l'on imite ses parents, et la période shu à l'adolescence où l'on agit en réaction à eux, ri correspond à l'âge adulte. Celui où nos actes, similaires ou différents, ont le poids des enseignements reçus et de nos expériences.
Bien entendu ceci est une présentation simplifiée de shu ha ri. En pratique les stades sont perméables, et les allers-retours entre les différentes étapes, nombreux."
Yokomen
en Aïkido
en Aïkido
Pourtant, la différence qui existe entre shomen uchi et yokomen uchi ne réside pas dans l’intention de faire shomen ou dans l’intention de faire yokomen, comme s’il s’agissait simplement là de deux options possibles, comme on décide le matin de prendre un thé plutôt qu’un café.
Shomen uchi consiste à couper avec le sabre dans une verticale parfaite. Ceci n’est possible que s’il n’y a pas de changement de garde au moment de la frappe. Si je me trouve dans une position telle que je peux abattre mon sabre sans avoir à faire un pas vers l’avant ou vers l’arrière, alors la verticale peut être parfaite, et la coupe devra pour cette raison être appelée shomen.
En revanche, si la distance est telle que j’aie besoin, pour toucher ma cible, d’inverser mes hanches, en faisant par exemple un pas vers l’avant, alors un élément biomécanique lié à ce changement de hanmi vient influencer et modifier le mouvement.
Car les passages simultanés de la hanche arrière vers l’avant, et de la hanche avant vers l’arrière, dessinent autour de la colonne vertébrale un mouvement circulaire inévitable, qui a évidemment peu d’amplitude, mais suffisamment tout de même pour être transmis, via les liaisons osseuses et les chaînes musculaires, à la partie supérieure du corps qui tient le sabre. Quand le sabre descend dans ce moment précis, il ne peut alors faire autrement qu’adopter un très léger angle qui est la conséquence absolument nécessaire de la faible rotation initiale engendrée par le changement de hanches.
Et bien, c’est cela qu’on appelle yokomen, et ce n’est que cela.
La différence entre yokomen et shomen n’est donc pas la conséquence d’un choix libre de « frapper yokomen » plutôt que de « frapper shomen », elle est uniquement le résultat de l’angulation du corps provoquée par l’inversion des hanches. Et c’est pourquoi l’angle de coupe pris par le sabre en yokomen est nécessairement peu important : parce qu’il est lié à cette inversion des hanches et à cela seulement.
On peut dès lors prendre comme référence la règle suivante, s’il y a inversion des hanches, la coupe du sabre est nécessairement yokomen.
La règle symétrique est tout aussi valable, s’il n’y a pas inversion des hanches, la coupe du sabre est nécessairement shomen.
En effet, couper yokomen sans inversion des hanches reviendrait à couper avec un angle qui ne serait pas une nécessité, pas issu du mouvement des hanches, et où les bras agiraient donc indépendamment de la partie basse du corps. Cela en Aikido ce n’est pas possible, c’est l’erreur classique des débutants qui balancent le sabre autour de leur tête avec de grands mouvement de bras qui les font ressembler à des moulins, parce qu’ils ne comprennent pas l’unicité de shomen et de yokomen.
Il est donc conforme à la réalité de dire que yokomen n’est jamais qu’un shomen accompli en inversant les hanches. Et cette vérité, si l’on prend la peine d’y réfléchir, signifie que le sabre japonais n’a qu’une seule coupe, dont l’angulation peut certes varier de quelques degrés, mais seulement en vertu d’une nécessité liée à la biomécanique, et pas du tout par la « décision » du sabreur de donner un angle à sa coupe.
Ceci a une grande importance, car on s’approche ici de deux idées fondamentales de l’Aikido :
La première, c’est que la technique est une et indivisible, et que ce sont seulement ses modalités d’application qui peuvent donner l’illusion qu’elle est multiple. L’Aïkido parle du Un, et il n’y a qu’une coupe en Aïkido.
La seconde, c’est que l’homme ne choisit pas la technique de combat la plus appropriée (car yokomen est effectivement plus approprié que shomen dans certaines situations), c’est au contraire cette technique qui s’impose à lui en vertu de critères indépendants de sa volonté, et qui pourtant proposent la réponse la plus pertinente au problème particulier auquel il se trouve confronté.
Et il n’y a pas loin de là à l’idée que l’homme en harmonie avec l’univers ne fait que laisser couler dans tout son être une force qui le dépasse infiniment, dont les ressorts s’imposent à lui comme autant de nécessités supra humaines, mais qui s’exprime néanmoins à travers lui dans la mesure où il ne cherche pas à s’opposer, par une volonté maladroite et intempestive, au cours naturel des choses.
Voilà comment, à partir d’une simple technique de coupe au sabre, on en vient à mieux comprendre la place de l’homme dans l’univers.
Philippe Voarino.
Le ki
en Aïkido
en Aïkido
Dès qu’on parle du ki on passe pour un mystique, une espèce d’hurluberlu : « Ce n’est pas scientifique, aucun instrument, aucune machine n’est capable de prouver, de démontrer que le ki existe ».
Je suis parfaitement d’accord. Effectivement si on considère le ki comme une énergie surpuissante, une sorte de magie capable de projeter des personnes à distance ou de tuer seulement grâce à un cri, comme on le croyait avec le kiai, on risque de s’attendre à des miracles et d’être très vite déçu.
Le ki une philosophie orientale ?
Quelle est cette philosophie « orientale » à laquelle nous n’aurions pas accès ?
Existe-t-il un domaine spécifique réservé à quelques adeptes, à quelques disciples triés sur le volet, ou bien cette connaissance est-elle à la portée de tous, et qui plus est, sans se compliquer la vie. Je veux dire en menant une vie normale, sans faire partie d’une élite ayant eu accès à des connaissances secrètes, sans avoir des pratiques spéciales, cachées et distribuées au compte gouttes, mais plus simplement en ayant un travail, des enfants etc.
Quand on pratique l’Aïkido, évidemment on est dans une recherche tant philosophique que pratique, mais c’est une recherche « exotérique » et non « ésotérique ».
Itsuo Tsuda a écrit neuf livres, créant ainsi un pont entre l’Orient et l’Occident pour nous permettre de mieux comprendre l’enseignement des maîtres japonais et chinois, pour le rendre plus concret, plus simple et accessible à tous. Il n’est pas nécessaire d’être oriental pour comprendre, sentir de quoi il s’agit. Mais il est vrai que dans le monde où nous vivons il va falloir faire un petit effort.
Sortir de nos habitudes de comportement, de nos références. Avoir un autre type d’attention, un autre type de concentration. Il ne s’agit pas de repartir de zéro mais de s’orienter différemment, de conduire notre attention (notre ki) d’une autre manière.
Déjà nous devons nous débarrasser de l’idée, très cartésienne, selon laquelle le ki serait une seule et même chose, alors qu’il est multiple. Admettre aussi que notre corps est capable de sentir des choses que l’on aurait du mal à expliquer rationnellement, mais qui font partie de notre vie quotidienne, comme la sympathie, l’antipathie, l’empathie.
Les sciences cognitives tentent à coup de neurones miroirs et autres procédés de décortiquer tout ça, mais cela n’explique pas tout, et même parfois ça complique les choses.
De toute façon à chaque situation il y a une réponse, mais on ne peux pas analyser tout ce que l’on fait à chaque instant en fonction du passé, du présent, du futur, de la politique ou de la météo. Les réponses surgissent indépendamment de la réflexion, elles surgissent spontanément de notre involontaire, que ces réponses soient bonnes ou mauvaises, l’analyse nous le dira après coup.
Le ki en Occident
L’Occident connaissait le ki par le passé, on l’appelait pneuma, spiritus, prana, ou tout simplement souffle vital.
Aujourd’hui cela semble bien désuet. Le Japon a gardé un usage très simple de ce mot que l’on peut retrouver dans une multitude d’expressions, que je cite plus loin, en reprenant un passage d’un livre de mon Maître.
Mais dans l’Aïkido qu’est-ce que le ki ?
Si une École peut et doit parler du ki, c’est bien l’École Itsuo Tsuda, et cela évidemment sans prétendre à l’exclusivité, mais simplement peut-être parce que mon Maître avait basé tout son enseignement sur le ki, qu’il avait traduit par respiration.
C’est pourquoi il parlait d’une « École de la respiration » : « Par le mot respiration, je ne parle pas d’une simple opération bio-chimique de combinaison oxygène-hémoglobine. La respiration, c’est à la fois vitalité, action, amour, esprit de communion, intuition, prémonition, mouvement. »
L’Aïkido n’est pas un art de combat, ni même de self défense. Ce que j’ai découvert avec mon Maître, c’est l’importance de la coordination de la respiration avec mon partenaire, comme moyen de réaliser la fusion de sensibilité quelle que soit la situation.
Itsuo Tsuda nous expliquait à travers ses textes ce que lui avait transmis son Maître Morihei Ueshiba. Pour nous le transmettre de manière plus concrète, pendant ce qu’il appelait « la première partie » – la pratique solitaire, qu’on appellerait aujourd’hui Taizo – au moment de l’inspiration, il prononçait KA, et à l’expiration MI.
Certaines fois il nous expliquait : « KA est le radical de Feu Kasai en japonais, et MI le radical de l’Eau Mizu ». L’alternance de l’inspire et de l’expire, leur union, crée Kami que l’on peut traduire par le divin. « Mais attention, nous disait-il, il ne s’agit pas du dieu des chrétiens ni même de celui d’une quelconque religion mais, si vous avez besoin de références, on peut dire que c’est dieu l’univers, dieu la nature, ou tout simplement la vie ».
Il y avait au dojo un dessin exécuté à l’encre de chine et tracé par Maître Ueshiba comportant quatorze formes très simples que nous appelions Futomani car O Senseï avait dit qu’il lui avait été dicté par Ame-no-Minaka-nushi : le Centre céleste.
Itsuo Tsuda en donne l’explication dans son livre Le dialogue du silence. Grâce à cela j’ai mieux compris les directions que prenait le ki lorsqu’il avait une forme.
Renouer, retrouver les liens avec ce qui préexiste au plus profond de nous.
Le fondateur parlait de Haku no budo et de Kon no budo : kon étant l’âme essentielle qui ne doit pas être étouffée, mais disait-il, on ne doit pas négliger l’âme haku qui assure l’unité de l’être physique. Une fois encore on parle de l’unité.
Si notre pratique s’intitule Aï ki do : « voie d’unification du ki », c’est bien que ce mot ki a un sens.
La pratique concrète nous permettra de le comprendre, mieux que les longs discours. Et pourtant il faut tenter d’expliquer, tenter de faire passer ce message si important, car sans cela notre art risque fort de devenir un combat « Que le plus fort, le plus habile ou encore le plus malin gagne », ou bien une danse ésotérique, mystique, élitiste, voire sectaire.
Et pourtant nous connaissons bien le ki, nous le sentons à distance. Par exemple quand on se promène dans une petite rue la nuit, et que tout à coup on sent une présence, on sent un regard dans notre dos et pourtant il n’y a personne !
Quant soudain on remarque, sur un toit avoisinant, un chat qui nous regarde. Un chat tout simplement, ou un rideau qui se rabat subrepticement. Le regard est porteur d’un ki très fort que tout le monde peut sentir, même de dos.
Une des pratiques de Seitai do appelée Yuki consiste à poser les mains sur le dos d’un partenaire et à faire circuler le ki. Il ne s’agit aucunement de faire l’imposition des mains pour guérir quelqu’un qui à priori n’est pas malade, mais d’accepter de visualiser la circulation du ki, cette fois comme un fluide, comme de l’eau qui coule. Au début on ne sent rien ou peu de chose de la part de l’un comme de l’autre. Mais là encore, petit à petit on découvre le monde de la sensation.
On peut dire que c’est une dimension à part entière dans la plus grande simplicité. C’est simple, c’est gratuit, ce n’est lié à aucune religion, on peut le faire à tout âge et quant on commence à sentir cette circulation du ki, la pratique de l’Aïkido devient tellement plus facile.
L’exercice de kokyu ho par exemple, ne peux pas se faire sans le kokyu, donc sans le ki, à moins de devenir un exercice de force musculaire, une façon de vaincre un adversaire.
Je n’aurais jamais pu découvrir l’Aïkido que mon Maître enseignait si je n’avais pas volontairement et avec opiniâtreté cherché dans cette direction. Dans la recherche sensitive, à travers tous les aspects de la vie quotidienne pour comprendre, sentir, et étendre cette compréhension sans jamais abandonner.
Ambiance
Le ki est aussi ambiance, par conséquent, pour pratiquer il y a besoin d’un lieu qui permette la circulation du ki entre les personnes.
Ce lieu, le dojo, doit à mon avis, chaque fois que cela est possible, être « dédié » à une pratique, une École.
Itsuo Tsuda considérait que en entrant dans le dojo on se sacralisait, et c’est pourquoi on saluait en montant sur les tatamis. Ce n’est pas un lieu triste où les gens « doivent garder un visage renfrogné et constipé.
Au contraire, il faut y maintenir l’esprit de paix, de communion et de joie. » L’ambiance du dojo n’a rien à voir avec celle d’un club ou avec celle d’une salle multi-sports qu’on loue quelques heures par semaine et qui est utilisée, pour cause de rentabilité, par différents groupes n’ayant rien à voir entre eux. Le genre de local, de gymnase où l’on passe, on s’entraîne, puis une douche et ciao ; au mieux une bière au bistrot du coin histoire d’échanger un peu les uns avec les autres.
Quand on connaît le ki, quand on commence à le sentir et surtout quand on veut découvrir ce qui se cache derrière ce mot, un lieu comme le dojo c’est vraiment tout autre chose. Imaginez un endroit calme dans un petit passage parisien au fond du vingtième arrondissement. Vous traversez un petit jardin et au premier étage d’un bâtiment très simple s’ouvre « Le Dojo ».
Vous y venez tous les jours si vous voulez, car chaque matin il y a une séance à sept heure moins le quart : vous êtes chez vous. Vous avez votre kimono sur un cintre dans les vestiaires, la séance dure à peu près une heure, puis vous prenez un petit déjeuner avec vos partenaires dans l’espace attenant, ou vous partez précipitamment au travail.
Le samedi et le dimanche grasse matinée, séances à huit heure.
Expliquer le ki est une chose difficile c’est pourquoi seule l’expérience nous le fait découvrir. Et pour cela il faut y mettre les conditions qui permettent cette découverte. Le dojo fait partie des éléments qui facilitent grandement la recherche dans cette direction. Renouer des circuits, mais aussi dénouer ces liens qui nous enserrent et obscurcissent notre vision du monde Petit à petit le travail va se faire, les nœuds vont se dénouer, et si nous acceptons qu’ils se dénouent on peut dire que le ki recommence à circuler plus librement.
Il circule à ce moment là en tant qu’énergie vitale, il est possible de le sentir, de le visualiser, de le rendre en quelque sorte conscient. Car des tensions inutiles, qui n’arrivent pas à se libérer, rigidifient notre corps. Pour rendre la chose la plus claire possible, on pourrait dire que c’est à peu près comme si un tuyau d’arrosage était bouché. Il risque d’éclater en amont.
La rigidification du corps oblige celui-ci à réagir pour sa propre survie. Il se produit alors des réactions inconscientes qui agissent au niveau du système involontaire. Pour éviter ces blocages, surviennent de micro fuites de cette énergie vitale et même parfois des fuites plus importantes, par exemple dans les bras, au niveau du koshi et principalement aux articulations.
La conséquence immédiate est que les personnes n’arrivent plus à pratiquer avec fluidité et c’est la force qui compense le manque, on raidit des parties du corps qui se mettent à réagir comme autant de pansements ou de plâtres pour empêcher ces déperditions de la force vitale.
C’est pourquoi il est si important de travailler sur le fait de sentir le ki, de le faire circuler. Au début c’est la visualisation qui nous le permet, mais au fur et à mesure qu’on approfondit la respiration (la sensation, la sensibilité au ki), si on reste concentré sur une pratique souple, si on se vide l’esprit, on peut découvrir, voir, sentir la direction du ki, sa circulation.
Cette connaissance nous permet de l’utiliser et la pratique de l’Aïkido devient facile. On peut commencer à pratiquer la non résistance : Le non faire.
La sensibilité naturelle des femmes au ki
Les femmes ont généralement plus de sensibilité par rapport au ki ou, plus exactement, elles la conservent plus, si elles ne se déforment pas trop pour se défendre dans ce monde d’hommes où tout est régi suivant les critères et les besoins de la masculinité, de l’image de la femme qui est transmise et de l’économie.
Leur sensibilité vient du besoin de conserver à leur corps la souplesse pour pouvoir accoucher de façon naturelle et s’occuper des nouveaux-nés. C’est une souplesse qui ne s’acquière pas dans les salles de sport, de musculation ou de fitness, c’est plutôt une tendresse, une douceur qui saura au besoin être ferme et sans aucune mollesse quand ce sera nécessaire. Le nouveau-né a besoin de toute notre attention mais il ne parle pas encore.
Il ne peut pas dire : « j’ai faim, j’ai soif ou je suis fatigué », ou encore « maman tu est trop nerveuse, calme toi, et dis à papa de parler moins fort, cela me fait peur ».
Grâce à leur sensibilité naturelle, elles sentent les besoins de l’enfant, elles ont l’intuition de ce qu’il faut faire et le ki passe entre la mère et l’enfant. Quant le père, toujours très rationnel, ne comprend pas, la mère sent et du coup elle sait.
Même si elle n’est pas mère, même si elle est une jeune femme sans aucune expérience, c’est le corps qui réagit, c’est lui qui a cette sensibilité naturelle au ki et c’est pourquoi, je pense, il y a tant de femmes dans notre École. C’est parce que le ki est au centre de notre pratique, que rien ne saurait se faire sans lui.
Nous mettons notre sensibilité dans cette direction et ainsi on peut voir le monde et les personnes non plus seulement au niveau des apparences mais bien plus loin, dans leur profondeur, ce qu’il y a derrière la forme, ce qui la structure, ou ce qui la conduit.
Voici quelques exemples que donnait Itsuo Tsuda, extraits du livre Le Non-faire : « La chose la plus difficile à comprendre dans la langue japonaise, c’est le mot « ki ».
En effet, si les Japonais l’utilisent des centaines et des centaines de fois par jour, sans y réfléchir, il est pratiquement, et je dirais aussi théoriquement, impossible d’en trouver un équivalent dans les langues européennes.
Si le mot, pris isolément, reste intraduisible en français, il n’est toutefois pas impossible de traduire les expressions courantes dans lesquelles il se trouve incorporé.
Je vais citer quelques exemples :
ki ga chiisai : mot à mot, son ki est petit. Il se fait trop de souci pour rien.
ki ga ôkii : son ki est grand. Il ne se fait pas de souci pour des petites choses.
… ki ga shinai : je n’ai pas de ki pour… Je n’en ai pas envie. Ou, cela me dépasse.
… ki ga suru : il fait du ki pour… J’ai le flair, le pressentiment, je sens intuitivement…
waru-gi wa nai : il n’a pas de mauvais ki, il n’est pas méchant, n’a pas de mauvaises intentions.
ki-mochi ga ii : l’état du ki est bon ; je me sens bien.
ki ni naru : cela attire mon ki, je n’arrive pas à dégager mon esprit de cette idée. Quelque chose de bizarre, d’anormal arrête mon attention, malgré moi.
ki ga au : notre ki coïncide, nous sommes sur la même longueur d’ondes.
ki o komeru : concentrer le ki. Pour la question de concentration, je n’ai vu nulle part ailleurs d’exemple aussi hautement porté qu’au Japon.
ki-mochi no mondai : c’est conditionné par l’état du ki. Ce n’est pas l’objet, le résultat tangible, mais c’est le geste, c’est l’intention qui compte.
On pourrait encore citer plusieurs centaines d’expressions avec le mot ki. Si les Japonais sont pour la plupart incapables de dire ce qu’est le ki, il n’empêche qu’ils savent instinctivement à quel moment il faut le dire ou ne pas le dire. ».
Itsuo Tsuda avait commencé l’Aïkido à l’âge de quarante cinq ans, il n’avait rien d’un sportif mais sa seule présence transformait toute l’ambiance du dojo. J’aimerais vous raconter une anecdote concernant un des exercices que je faisais dans les années soixante-dix, alors que mon Maître avait déjà plus de soixante ans.
Lorsque je passais le portail de la cour au fond de laquelle se trouvait le dojo, je m’arrêtais un instant, je fermais les yeux et cherchais à sentir si « il » était là.
Les premiers temps cela ne marchait pas trop, c’était des coups au hasard, des coups de chance. Petit à petit j’ai compris : je ne devais pas chercher à savoir. Alors j’ai commencé à me « vider », à cesser de penser et c’est venu. Je savais chaque matin si il était arrivé ou non. Je sentais sa présence dès que je m’approchais du dojo.
A partir de ce moment quelque chose s’est transformé en moi. J’avais enfin compris un petit bout de son enseignement, et surtout, j’avais vérifié que le ki ne faisait pas partie de l’irrationnel, que c’était concret, et que sa perception était accessible à tous puisqu’elle m’avait été accessible.
Régis Soavi, Dragon Magazine

Traditionnellement, il semble que ki était utilisé dans le sens d’intention dans le monde martial. Un choix qui a été perpétué dans le monde du Kendo.
Dans d’autres disciplines, la signification de ki s’est étendue. Au point parfois, comme en Aïkido, de devenir flou…
Lorsque j’ai débuté la pratique martiale je cherchais le MEILLEUR art, pour devenir LE plus fort. Je gesticulais à la recherche de LA vérité, qui sans cesse semblait m’échapper.
Chaque théorie que j’échafaudais s’écroulait à mesure que j’accumulais les expériences, chaque certitude volait en éclat à mesure que je multipliais mes rencontres.
Aujourd’hui, après quatre décennies de pratique et la rencontre de nombre des plus grands maîtres contemporains du monde martial, j’ai appris la tolérance, le recul, la perspective.
Rares sont les mouvements, principes, stratégies, qui ne soient exprimés différemment selon le contexte, le vécu et les objectifs de chacun.
Le ki est un concept complexe, qui résiste à une définition simpliste. Ci-dessous vous ne trouverez donc pas LA véritable définition du ki.
Simplement le partage d’expérience de vies entières de pratique. Des points de vue différents qui aident à saisir la notion de ki dans sa multiplicité, enrichiront notre compréhension individuelle, et nourriront nos recherches.
Les maîtres ci-dessous ont toutefois en commun un point essentiel. Le refus des manifestations spectacles, et toute tentative de mystification.
Kono Yoshinori, Akuzawa Minoru, Hino Akira
Le refus des manifestations spectacles, et toute tentative de mystification.
Irie Yasuhiro
On peut développer une force bien plus importante que les capacités musculaires. Si on arrive à utiliser cela, les techniques fonctionnent à un tout autre niveau.
Est-ce le ki ? Je n'aime pas employer ce terme. Comme je le disais précédemment, en devenant célèbre les adeptes ont pour habitude de déclarer "Ceci est l'Aïki !" ou "Ceci est le ki !" lorsqu'ils font des démonstrations spectaculaires.
Mais ce n'est ni reproductible ni efficace sur des personnes ne faisant pas partie de l'école. Il n'y a aussi toujours que le maître qui est capable d'utiliser et démontrer le "ki", l' "Aïki".
Ça ne correspond pas à ma conception des choses. Je pense que l'on utilise le terme ki pour désigner un ensemble de choses très concrètes et transmissibles qui vont des angles à la distance, en passant par la hauteur où a lieu la technique. Des choses qui doivent être enseignées clairement.
Et dans cela il y a une façon de faire le mouvement sans force. Il faut la faire sentir encore et encore et guider l'élève pour qu'il puisse l'acquérir. Rien de magique ou de vague.
Saotome Mitsugi
Osenseï employait le mot "ki" dans de nombreux sens. Pour lui la concentration était le ki. Parfois il s’en servait pour décrire la confiance, la vitalité, souvent la force de l’univers et la fonction de Dieu. Il n’existe pas de définition complète : il faut appréhender la réalité.
Christian Tissier
Que représente le ki pour vous ?
La vie, le souffle de vie qui est en tout. Le problème du ki c’est son écoulement. Si le ki ne s’écoule pas naturellement on est malade, bioki.
Pratiquez-vous des exercices comme le chi-kung ?
J’ai énormément de respect pour le chi-kung, le Taï chi. Mais je pense que leur propos est dans l’écoulement du ki et je pense que l’Aïkido le permet aussi sous une autre forme mais qui est suffisante.
Yamada Yoshimitsu
Qu'est-ce que le ki pour vous ?
Pour moi le ki n'est pas seulement quelque chose qui se manifeste sur le tatami. Le ki est présent à chaque instant, même dans la vie quotidienne. C'est une énergie invisible mais à laquelle je crois.
Quelque chose qui nous permet d'agir, penser, interagir positivement avec les gens, la société.
Ce n'est pas quelque chose de réservé aux artistes martiaux. On dit parfois de quelqu'un qu'il a beaucoup de ki, un ki fort. C'est quelque chose que l'on perçoit autour des gens qui rencontrent le succès. Une sorte d'aura positive.
Et c'est un état permanent. Quoi que l'on fasse, à n'importe quel instant de sa vie.
Au départ l'Aïkido est devenu extrêmement populaire parmi les hippies. Et ils ne voulaient entendre parler que de la puissance du ki.
Ils venaient ici et ne travaillaient pas ! Un jour je faisais faire kokyu dosa et un élève était immobile, dans une intense… concentration peut-être.
Au bout d'un moment je lui tape sur l'épaule et lui dit "Mais qu'est-ce que tu fais ?".
Il me répond "Senseï, ne me dérangez pas, j'étends mon ki.". C'était ce type de mentalité. Ils ne prenaient que la partie sur le ki.
Je leur disais, comme Toheï senseï, "Un ki fort a besoin d'un corps fort."
(…) Il faut toujours ancrer les choses dans le "réel", que cela influe positivement notre vie quotidienne.
Il y a aussi eu les livres de Toheï Koichi qui ont été publiés. Le pays était embourbé dans la guerre du Vietnam, et toute une génération était à la recherche de spiritualité.
Sa pratique basée sur le ki était très attractive pour les jeunes américains de l'époque, et il a rencontré un écho très favorable. Ils ont commencé à tout faire avec le ki. (Rires)
Est-ce que vous parlez aussi de ki dans votre enseignement ?
Non. Toheï n'avait d'ailleurs pas besoin de ki ou quoi que ce soit d'ésotérique. Il était très puissant, souple et relâché.
Je crois que le terme ki a simplement été un outil qu'il a utilisé pour le développement de l'Aïkido. Et c'était très malin. Il disait d'ailleurs aussi aux gens qui rêvaient trop "Un ki fort a besoin d'un corps fort.".
Beaucoup de pratiquants ont dû venir vous voir en espérant apprendre à maîtriser le ki ?
Oui ! J'avais du mal à répondre à leurs attentes, et beaucoup ont dû être déçus. (Rires)
Kono Yoshinori
Quelle est selon vous la place du ki dans la pratique ?
Il y a de nombreux écrits qui ont défini le ki de nombreuses façons. Mais une chose intéressante à prendre en considération est qu'il s'agit d'une notion qui n'était pas utilisée à l'époque de Miyamoto Musashi.
C'est une notion qui a été popularisée à l'époque Edo lorsque beaucoup de gens sont devenus capables de lire les classiques chinois.
Sasaki Masando
Qu'est-ce que le ki ?
Je m'appelle Sasaki Masando et je suis immortel.
Le corps est un instrument. Sa durée de vie est limitée. Mais il y a quelque chose d'éternel en nous.
Certains l'appelle âme. En Aïkido on parle de Ki. Cette part de l'homme est, tel le mont Fuji, immuable.
Un poème de Yamaoka Tesshu dit :
"Harete yoshi
Kumorite mo yoshi
Fuji no yama
Moto no sugata wa
Kawazari ni keri"
Quoi qu'il arrive notre essence immortelle est immuable.
(N.d.a. : Traduction très approximative du poème "Par temps clair, par temps nuageux, le mont Fuji, forme des origines, est inchangé".)
Hiroo Mochizuki
Comment définiriez-vous le ki ?
Ki c'est l'énergie, mais aussi l'intention. Et c'est la sensation qui est intéressante.
J'ai surtout compris cela avec… la boxe ! En boxe il y a la théorie. Si j'ouvre ici il va venir là, etc. Mais dans la réalité ça va très vite. Trop vite pour voir. Et c'est là qu'il faut que ce qui est entré dans la tête soit intégré dans le corps pour que cela devienne instinctif.
Dans l'action on ne peut pas regarder, calculer, il faut ressentir, percevoir avec le corps. C'est ça pour moi la partie la plus intéressante de l'utilisation du ki.
Et c'est quelque chose qui est en chacun de nous, que l'on pratique les arts martiaux ou pas. C'est ce qui fait que quelqu'un dont vous regardez intensément le dos se retourne quelle que soit la distance.
Shimizu Kenji
Comment définissez-vous le ki ?
En Aïkido on parle souvent de ki mais c'est une idée abstraite qu'il est dur de comprendre.
Si on parle de ki il y a avant tout le kimochi, le travail du cœur. C'est de là que vient la vigueur et l'énergie. C'est un principe fondamental bien plus important que la force musculaire.
La puissance découle de la force morale. Quand on écoute les récits des survivants de la guerre on comprend que si le ki faiblit la mort est assurée.
Sans nourriture ni espoir pour le lendemain seule la force morale (kiryoku) permet de survivre.
Si l'on perd espoir on meurt. C'est le ki qui guide et dirige l'homme.
Plus qu'une énergie physique le ki est donc une force spirituelle ?
L'âme est la source du ki. Je ne voudrais pas que les gens se méprennent sur ce que je vais dire mais je ne crois pas que l'on puisse enseigner ce qu'est le ki.
C'est une chose que l'on doit expérimenter et comprendre soi-même par la pratique. Certaines personnes ne sont intéressées que par la technique et veulent devenir fortes en se concentrant dessus.
Mais même en acquérant une solide technique, seule elle est inutile. Si l'esprit n'est pas fort lorsqu'il est nécessaire de faire face, le cœur fuira malgré la puissance du corps.
Dans l'ancien temps dans l'entraînement du Budo on utilisait le corps pour renforcer l'esprit pendant la pratique. Shin shin tanren, forger le corps et l'esprit.
L'Aïkido est exactement cela, il sert à renforcer le corps et l'esprit de manière unifiée. C'est une chose très difficile pour l'homme.
Il ne faut pas se limiter à l'apprentissage de formes techniques. On débute par l'étude des formes, les katas, puis on les oublie pour rentrer véritablement dans la technique. Répéter simplement la forme nous fige et bloque notre évolution.
Hino Akira
Pratiquez-vous des exercices de développement du ki tels que le Qi Gong ?
Notre pratique est basée sur la sensibilité et c'est cela qui développe le ki. Il n'y a donc pas d'exercices spécifiques mais tout notre travail doit le développer naturellement.
Akuzawa Minoru
Beaucoup d'arts martiaux utilisent le terme de ki. Qu'en est-il en Aunkaï ?
C'est un terme que je n'utilise pas. Mais le ki est l'intention et la conscience. Donc il est évidemment développé dans tous les exercices que nous travaillons.
Mais je ne projette pas de ki. (rires)
Fujiwara Hironobu
Comment interprétez-vous l’expression ki ken tai ichi ?
(Rires) C’est périlleux car parler précisément de tels fondements nous expose à être réprimandé par un grand maître qui aurait une vision différente.
À un premier niveau de lecture, c’est l’union entre l’intention, le sabre et le corps dans l’action. Si on creuse plus profondément on arrive à des interprétations plus personnelles. Par exemple pour moi, ki recouvre ici l’intention, et implique de s’engager en confiance, d’être déterminé dans son action.
Pour le ken c’est évidemment le sabre en tant qu’objet, mais aussi la technique qui sous-tend son utilisation, par exemple la ligne de coupe. Enfin pour le corps, il y a un accent particulier sur les déplacements qui sont au cœur de la discipline.
Il y a donc un degré de lecture où l’on parle d’harmonie entre la détermination, la technique et le déplacement. Mais c’est loin d’être le seul, et il y a beaucoup d’interprétations possibles.
C’est ce qui peut amener à considérer que même si il y a une touche, s’il manque un de ces éléments, il n’y a pas de véritable ippon.
Comment définissez-vous le ki ?
(Rires) C’est une question immense, et à vrai dire je ne saurai y répondre de façon réellement pertinente. Je dirai que le ki est ce qui emplit le ma, l’intervalle, l’espace-temps qui nous relie et nous sépare. Que c’est ce qui nous fait nous sentir triste lorsque l’on voit quelqu’un de triste. C’est un des fondements de notre humanité.
Léo Tamaki, Budo - Bujutsu
Ushiro waza
les techniques arrières
les techniques arrières
Cependant, comme c’est souvent le cas avec les arts martiaux japonais, si son étude propose une valeur « faciale » questionnable, l’intérêt « caché » dont il est le vecteur devrait faire pencher la balance en sa faveur et, comme je vais tâcher de le démontrer, il serait probablement dommageable de l’éliminer de notre gamme d’exercices.
En effet, une analyse un peu plus poussée de son fonctionnement permet de mettre en évidence des éléments qui peuvent être utilement développés pour le bénéfice global de notre discipline. En dépit des apparences, à moyen et à long terme, ces techniques se révèlent non seulement tout à fait cohérentes structurellement mais aussi véritablement susceptibles d’apporter des outils utiles à l’amélioration de l’ensemble de nos pratiques…
Des origines…
Pour des raisons historiques, les saisies « arrière » étudiées en Daïto Ryu (l’école sur laquelle se fondent à peu près 90% des techniques de l’aïkido « moderne ») sont effectuées par un Uke qui, à une exception près, se présente face à Tori ou arrive derrière lui. En effet, sur les 118 techniques que compte le premier curriculum de l’école Hiden Mokuroku (« Programme Secret »), une seule voit Uke arriver latéralement.
Ces formes de travail s’apparentent donc à des situations proches de situations militaires de type « commando », l’attaquant visant à éliminer ou contrôler une sentinelle après une approche furtive dans le dos de cette dernière. La procédure consiste à « fixer » le plus rapidement possible l’adversaire via une « immobilisation debout » de type Kubi-Shime, avant de procéder à un égorgement à l’aide d’une arme blanche, ou, à défaut, à un « embrochage » au niveau des reins, de la rate ou du foie.
Bien sûr, en Aïkido, il sera toujours utile de se référer aux formes en Go No Geiko, issues du Daïto Ryu, ces approches « primaires » du travail, afin de savoir comment procéder au mieux si jamais l’on devait se retrouver prisonnier d’une telle « immobilisation debout ». A priori, dans le cadre du développement de Zanshin, l’attention à notre environnement devrait limiter le besoin de recourir à de tels exercices (cette situation est censée ne jamais se produire pour un aïkidoka « vigilant » ) mais comme il est toujours plus prudent de s’entraîner à reconnaître et à fréquenter les situations les plus compliquées mieux vaut prévenir que guérir et… mourir ! Apprendre donc à gérer cette première gamme d’exercices statiques sur le tatami (comme lorsque l’on est « immobilisé ») avant de passer à des applications plus dynamiques n’est probablement pas superflu. Le but le plus important de notre pratique restant avant tout de survivre dans le cas peu probable où nous serions confrontés à des situations d’attaques arrière dans la rue, le pragmatisme doit rester de règle.
À notre époque…
De nos jours, en Aïkido, le travail escompté lors d’un passage de grade est à effectuer en Ju No Geiko (voire en Ryu No Geiko) et Ushiro Waza n’y fait pas exception. Sa mise en œuvre est quasi systématiquement effectuée par le biais de saisies, l’unique exception étant représentée par Eri dori qui laisse à Uke une main libre susceptible de frapper Tori (comme c’est d’ailleurs également le cas en Daïto Ryu).
En dépit de son apparence « moderne », l’une des explications avancées pour justifier cette forme de déclenchement des attaques en Ushiro Waza est à rechercher dans l’Histoire nippone d’avant l’ère Meiji, lorsque les Samouraïs portaient encore le sabre à la ceinture.
L’argument fourni est loin d’être incohérent puisqu’il consiste à dire que, à l’époque médiévale, un adversaire « désarmé », sûrement un peu fou ou désespéré, pouvait songer à tenter d’invalider le dégainement du sabre de son ennemi en essayant de bloquer ses bras le mieux possible.
Pour ce faire, il essayait de contrôler la main droite de Tori (censée dégainer en premier) avant de passer derrière ce dernier pour le neutraliser… en espérant être assez rapide pour pouvoir le faire. L’opération pouvait cependant s’avérer plutôt risquée car se hasarder à attaquer par derrière était, on le conçoit aisément, au moins aussi dangereux que d’être attaqué…
Cette justification ne tient d’ailleurs théoriquement la route que si l’on part du principe que les origines de l’Aïkido sont à rechercher dans le Japon médiéval. Par contre, si l’on veut voir dans notre pratique une « création » plus récente, elle ressemble plutôt à une interprétation à posteriori… Peut-être que, en ce qui concerne les « éclaircissements » régulièrement apportés quant aux origines de notre discipline, la réalité se situe en un juste milieu, entre une vision probablement un peu trop passéiste et un réductionnisme visiblement un peu trop contemporain.
L’influence de certains éléments issus du passé martial japonais se montre de façon suffisamment palpable dans nos approches pour que le doute ne soit pas permis même si des influences plus récentes y sont aussi visibles de façon concurrente.
Avant toute tentative d’analyse théorique, il semble honnête de reconnaître que, même si l’on peut s’interroger sur la validité des explications quant à la mise en œuvre de leur « introduction » technique, ces exercices « arrière » tentent de proposer des outils qui pourraient se montrer utiles dans un cadre combatif plus général. Leur principal intérêt ne réside en effet pas uniquement dans leur efficacité directe (se défendre contre une agression par l’arrière) mais dans la capacité que Tori peut ainsi développer dans le guidage du corps d’Uke autour de lui, que ce soit sous des angles latéraux ou arrière.
Pour qu’une telle éducation au guidage puisse s’enclencher, on veillera à inciter Tori à prendre d’abord, avant le début de la technique – une position de garde statique, bras avant en extension à un niveau médian. Pour pénétrer dans la sphère de Tori, Uke devra alors, soit contourner ce « bras obstacle », soit le repousser au mieux en tentant d’exercer sur lui une pression latérale ou abaissante. Le but d’une telle manœuvre sera pour lui d’éliminer la gêne provoquée par ce bras lorsqu’il tentera de pénétrer dans le « territoire » de Tori.
Par sécurité, il devra rapidement faire suivre cette première pression d’une saisie de la main, du coude, de l’épaule… Tori devra alors à son tour s’adapter à cette tentative de domination territoriale en incitant Uke à passer derrière lui. Pendant ce mouvement, Tori doit veiller à conserver le contrôle d’Uke lors de sa tentative de contournement. Voyant une ouverture se créer, Uke se déplacera en passant derrière Tori en un mouvement rotatif afin de tenter d’effectuer une saisie avec sa seconde main dans le but d’invalider la partie encore libre de son adversaire (son bras, son poignet, son coude, son épaule, son col ou encore son cou via un étranglement). Tori part donc d’une posture statique, mais non rigide, avant de mettre en mouvement un effacement dynamique afin de gérer au mieux les déplacements d’Uke.
Cette façon de procéder permet d’éclairer deux des principes sous-jacents aux moyens à mettre en œuvre pour canaliser les mouvements d’Uke. En fait, pour Tori, la compétence à développer consiste ni plus ni moins à apprendre à gérer un adversaire sortant de son champ de vision d’un côté de son corps pour l’amener à réapparaître de l’autre côté de celui-ci.
Ces attaques arrière visent donc significativement à enseigner à l’apprenant les moyens de faire passer son agresseur de la droite vers la gauche et vice-versa en modifiant les angles et positions de son propre corps. Une telle approche pousse d’une part le pratiquant à conceptualiser les principes en action et, d’autre part, le conduit à développer ses capacités de perception afin d’apprendre à mieux appréhender ce que l’on ne voit pas, ce qui est indiscernable puisque derrière soi.
Bien sûr, cette démarche doit rester pragmatique, les sensations à développer n’étant pas ésotériques mais proprioceptives. On remarquera au passage que des entraînements de ce type n’existent plus dans les autres arts martiaux, devenus sportifs (judo, karaté ou autres…). En ces temps de baisse des effectifs de nos dojos, ils peuvent donc présenter quelque intérêt pour d’éventuelles recrues…
La capacité qu’Ushiro Waza est donc censé nous faire développer est celle d’une disponibilité à des attaques arrivant éventuellement de face mais surtout de côté ou de l’arrière. En fait, il s’agit d’amener les pratiquants à un degré de conscience qui les rendra capables de « voir » derrière eux comme s’ils avaient des yeux derrière la tête.
L’enseignement qui est à retirer d’une telle pratique ressort de la gestion de l’inconnu, de l’aiguisage d’une sorte de sixième sens apprenant à capter l’intention de l’agresseur avant que son attaque ne soit complètement aboutie voire complètement conceptualisée.
Pour revenir sur l’idée de Zanshin évoquée plus haut, il s’agit à terme d’apprendre à être capable de s’adapter instantanément à l’inattendu, d’abord sur un tapis puis, éventuellement, dans la « vraie » vie.
En Aïkido, ce type de perception de l’espace ne se trouve pas uniquement dans les exercices en Ushiro Waza puisque, dès le début de la pratique, il s’étudie dans diverses facettes de nos entraînements. Il est par exemple, très tôt attendu du pratiquant qu’il s’accoutume aux Ushiro Ukemis, ces roulades qui apprennent à partir vers l’arrière sans vraiment voir ce qui s’y trouve. Il est à remarquer également, de façon certes plus discrète, dans certaines des situations rencontrées lors de l’entraînement aux randoris… avec des adversaires arrivant de plusieurs directions, parfois conjointement. Une autre approche visant à développer entre autres la perception périphérique se rencontre également dans la position Hanmi Handachi Waza. Et puis, d’une façon décalée, des aspects similaires du « contrôle » de l’espace périphérique sont à repérer dans certains des entraînements au Bokken ou au Jo. En clair, les études en Ushiro Waza sont donc loin d’être déconnectées des procédures pédagogiques d’autres aspects de notre discipline…
Les deux versions que je vais évoquer peuvent bien sûr accepter des variations, à la marge.
Pour décrire au mieux la première forme à prendre en compte dans ce genre de travail, si l’on conçoit que le travail en Ushiro Waza consiste avant tout à apprendre à Tori à faire passer son attaquant de la droite de son corps à sa gauche, et vice-versa, lorsque Uke saisit le poignet droit de Tori, (qui est alors classiquement en position Aï Hanmi) celui-ci choisit d’avancer dans le même temps sa jambe arrière (la gauche) comme s’il allait effectuer une entrée en Irimi sur le corps d’Uke en Aï Hanmi Kataté Dori.
Ce déplacement ambitionnera de motiver un mouvement similaire d’Uke en un déplacement « miroir ».
Pour inciter Uke à avancer, Tori pourra soit le pousser au niveau du coude (en une sorte d’Ude Kime « Nage ») soit lui menacer le visage / la gorge afin de l’amener à avancer sa jambe arrière (en l’occurrence sa gauche également) pour se protéger et tenter de contrôler à son tour l’autre bras de Tori par l’arrière en lui saisissant le poignet gauche (ou le coude, l’épaule, le col, la gorge…).
Cette approche en Irimi/Omote présente deux avantages principaux.
D’abord elle est conforme à l’idée qu’un enseignant d’art martial devrait rapidement mettre à la disposition de « ses » débutants les moyens d’assurer leur sécurité au mieux lorsque ceux-ci rejoignent sa discipline.
Pour ce faire, il est incontournable d’aider ces derniers à reconnaître le danger et à accepter de le fréquenter dans le dojo, le but d’une telle démarche étant de diminuer un éventuel effet de surprise contre productif si jamais une véritable agression devait se produire en dehors de l’entraînement.
Cependant, s’il faut, de manière précoce, enseigner des mouvements permettant très vite de se défendre au mieux en situation réelle, il ne faudrait pas que l’apprentissage se cantonne pour autant à faire croire à un mode uniquement défensif face à un attaquant restant dominant.
En clair, à terme, ne penser qu’à se défendre pourrait devenir négatif pour le pratiquant, celui-ci ayant tout intérêt à se forger parallèlement un moral de gagnant (ce qui sous-entend qu’il ne faut pas limiter l’apprentissage à des formes trop proches du principe de l’échappatoire). Évidemment, avec le temps, il faudra également montrer comment un vrai principe d’évitement, et non une fuite due à la peur, peut se révéler intéressant à travailler quand il est mis en place intelligemment.
À l’évidence, il ne s’agit nullement de s’avancer candidement vers l’attaquant en se mettant en danger mais bien d’employer les outils fondateurs que l’Aïkido fournit, en l’occurrence, Irimi.
Il faut donc que l’apprenant comprenne son rôle, sa mission et utilise les mécanismes biomécaniques et théoriques de notre discipline afin de peaufiner l’acquisition des bases.
Ensuite, on pourra remarquer que cette première forme d’enclenchement des techniques sur Ushiro Waza (en Irimi/Omote) participe à la mise en place d’un apprentissage qui va aider l’apprenant à vérifier l’importance du guidage « entrant » via la contrainte exercée par la main de Tori sur le coude d’Uke (ou par la menace vers la tempe, la carotide ou encore les côtes…).
Ce sont ces pressions ou intimidations ciblées qui pourrons aider Tori à faire se déplacer Uke.
L’enseignement que l’on peut retirer de tels entraînements est à repérer dans la recherche de l’adaptabilité, de la mobilité et des capacités d’association et de dissociation des parties de son corps…
À terme, une fois les principes techniques acquis, le pratiquant pourra constater l’intérêt d’un autre élément, caché de prime abord, qui consistera à faire croire à l’attaquant qu’on lui fournit des appuis stables… avant de les lui retirer.
Tori pourra de la sorte développer sa capacité à déstabiliser Uke pendant ses déplacements.
Une fois cette première forme d’entrée « domestiquée », il sera nécessaire d’en compléter l’étude en en travaillant une seconde qui peut paraître un peu plus théorique lorsque l’on commence à l’aborder mais qui se révélera cependant également très formatrice à terme. J’appellerai arbitrairement cette étape celle du « Taï Sabaki aspirant ».
C’est une approche qui peut être conçue d’au moins deux manières.
Il s’agira tout d’abord d’un guidage « aspirant » du déplacement d’Uke via une connexion fine entre les bras avant des deux partenaires. Conjointement avec ce contact, Tori visera à libérer l’espace en réalisant un Okuri Ashi, en un effacement de biais devant Uke pour que ce dernier ne rencontre pas d’obstacle dans son avancée et soit tenté de le contourner.
Lors de la première étape de la procédure, lorsque Tori voudra commencer à effectuer ce « Taï Sabaki aspirant », il devra prendre en considération que, pour pouvoir se rapprocher de lui et pénétrer dans sa garde (comme cela a été évoqué plus haut) Uke devra de son côté trouver les moyens d’abaisser le bras avant de son adversaire.
Lorsque Uke s’engagera dans cette action, Tori fera alors « semblant » d’accepter la pression exercée en abaissant progressivement son propre bras de manière à conserver la connexion qui se sera créée, dans le but de mieux guider le bras d’Uke (autant que possible à son insu).
Il s’agira alors pour lui de peaufiner la gestion synchronisée de son mouvement avec celui de son partenaire. En abaissant ce bras, le but de Tori sera d’amener Uke à avancer son pied arrière par compensation.
Tori devra alors laisser penser à Uke qu’il va aisément parvenir à saisir l’autre bras de Tori en passant derrière lui. Pour que cette opération soit possible Tori devra, dans un premier temps, s’effacer conjointement par un mouvement de pas glissants (Ushiro Okuri Ashi évoqué plus haut) effectués en diagonale arrière, à l’opposé de la position qu’Uke occupe au début de la technique.
L’idée sera de conduire ce dernier à emprunter le passage laissé libre. Dans un second temps, Tori avancera son pied arrière en diagonale avant vers l’extérieur afin de laisser la possibilité à Uke de saisir son autre poignet (coude, épaule…) sans que ce dernier puisse pour autant s’y accrocher ou le bloquer.
La clef de la réussite résidera, comme toujours, dans la gestion exacte du tempo des mouvements d’Uke. Le dessin que les pieds d’Uke traceront sur le sol sera en forme de V majuscule.
Concernant la phase de création de vide, cela sera en fait beaucoup plus simple à effectuer qu’à expliquer par écrit ! Toujours dans un esprit de synchronisation rigoureuse, cette phase sera à enclencher au moment où la première saisie d’Uke débutera.
Cependant, au lieu de procéder en faisant obstacle à la pression d’Uke, Tori, dès le contact établi relâchera intelligemment et progressivement son bras de lui-même (« de l’intérieur » c’est-à-dire en se détendant mais sans s’abandonner, ni psychologiquement, ni physiquement !).
Son but sera de déséquilibrer Uke en créant une sorte de vide. Le déplacement alors effectué ne diffèrera pas de celui expliqué pour la version du « Taï Sabaki aspirant », c’est-à-dire le mouvement en V évoqué, mais il devra se mettre en place de manière encore plus coordonnée que dans la première forme (en suivant le principe de Ri-aï).
Une telle approche présentera également l’avantage de permettre des mouvements amenant à la conscience des concepts d’ouverture et de fermeture du corps de façon associée entre Uke et Tori.
La suite des opérations pourra grandement varier en fonction des techniques que l’on désirera effectuer. On pourra par exemple envisager la création d’un vide vertical dans Ikkyo ou bien aborder la notion d’escamotage du corps pour Shiho Nagé ou Koté Gaeshi…
Le succès des techniques qui suivront viendra bien sûr de la bonne organisation des premières étapes des techniques, phases qui sont régulièrement imprécises et bâclées (lors des passages de grades…) par manque de réflexion quant aux aspects théoriques et biomécaniques sous-jacents à un travail en Ushiro Waza cohérent.
Pour résumer les quelques réflexions qui précèdent, ce qu’il faudra travailler via les types d’exercices proposés – au-delà des aspects purement techniques, ce sera donc la mise en route et la « domestication » d’une vision périphérique la plus ample et la plus disponible possible. L’appropriation d’une telle compétence pourra progressivement donner accès à une perception plus intuitive de l’espace, faculté qui est l’un des outils fondamentaux susceptibles de servir utilement à une réalisation harmonieuse de l’ensemble de nos pratiques.
Au titre de la nomenclature envisageable voici la liste des saisies et « ceinturages » arrière potentiels :
Ryote Dori, Ryo Hiji Dori et Ryo Sode Dori, Ryo Kata Dori, Katate Dori Kubi-Shime, Haga Iijme (ceinturage « serré » à bras le corps) mais aussi Uwate Dori (encerclement par-dessus les bras), Shitate Dori (par-dessous les bras), Ude Dori (sous les bras) sans oublier les éventuelles prises par les cheveux, la nuque, etc. Jean-Marc Chamot
Le lexique de l'Aïkido
Heureusement, une représentation visuelle des mots utilisés est bien souvent largement suffisante : par exemple shomen uchi évoque à tout pratiquant d’aïkido une attaque bien précise.
C’est pourquoi je me propose de vous lister ci-après le vocabulaire que les pratiquants d’aïkido emploient communément et de tenter de donner un sens plus précis à quelques-uns d’entre eux. La connaissance de quelques mots de base suffit d’ailleurs à comprendre beaucoup de termes spécifiques à l’aïkido.
Cependant, cette liste des mots présentés ici n’est pas exhaustive, loin s’en faut. Le but premier de ce petit dictionnaire est de permettre de mémoriser plus facilement ces termes en les voyant écrits.
Termes de base
Ki : Energie
Kokyu : Respiration, puissance respiratoire Ko=expiration, kyu=inspiration).
Hara : Centre vital (ventre).
Tori (nage, ou shite) : Celui qui exécute la technique.
Uke : Celui qui subit la technique.
Seiza : Position de repos, à genoux.
Taï Sabaki : Déplacement du corps (Taï = corps, sabaki = esquiver, déplacer).
Tenkan : Déplacement circulaire sur un pivot.
Irimi : Déplacement direct vers le centre (Iri = centre).
Omote : Positif (en passant devant).
Ura : Négatif (en passant derrière).
Tachi waza : Travail debout.
Suwari waza : Travail au sol.
Hammi handachi waza : Travail à genoux avec uke en position debout
Kaeshi waza : Travail de contre techniques (Les contre techniques ne doivent être enseignées qu’à partir du moment où l’élève a acquis une bonne connaissance de l’ensemble des techniques de base, c’est-à-dire plus ou moins au niveau du 3ème dan. Toute tentative de les enseigner trop tôt risquerait de désorienter un pratiquant dont la compréhension de l’Aïkido est encore précaire.)
Henka waza : Travail d’enchaînements et de variations.
Jo nage waza : Travail de projections avec un jo sur uke.
Jyu waza : Travail libre en fin de cours.
Jiu waza (Ju waza) : Travail de souplesse = Ju no geiko (jiu ou ju = souplesse).
Bukki waza : Travail aux armes.
Suburi : Exercice de frappes répétées au boken.
Shikko : Déplacement à genoux.
Tsugi Ashi : Marche glissée.
Ukemi : la chute.
Kyu : Grade décerné avant les dan.
Kokyu Ho : Exercice d’expansion de l’énergie interne par la respiration.
Bokken : Sabre en bois.
Jo : Bâton (1,28m).
Tanto : Couteau.
Hakama : Pantalon ample et plissé porté par dessus du pantalon.
O Sensei : Ce terme désigne Maître Morihei Ueshiba (fondateur d’Aïkido).
Sensei : Professeur (ou simplement l’Ancien).
Fuku Shidoin : Aide-Instrusteur.
Shidoin : Instrusteur.
Shihan : Maître.
Mudansha : Les grades de Kyu (de Ro kyu à Ik kyu = 6ème kyu à 1er kyu).
Yudansha : Les grades de Dan (à partir de Sho Dan = 1er Dan).
Dojo : Salle où l’on pratique les arts martiaux
Kamiza : Partie du dojo où est placé le portrait de O Sensei.
Anatomie
Taï : Corps
Men : Tête
Kubi : Cou
Eri : Col
Mune : Poitrine
Kata : Epaule
Ude : Bras
Hiji : Coude
Sode : Manche
Kote : Poignet
Tekubi : Poignet (Cou de la main)
Te : Main
Hara : Ventre
Koshi : Hanche
Hiza : Genoux
Ashi : Pied
Saisies et attaques
Saisies de face
Aï hanmi katate dori : Saisie du poignet homologue.
Gyaku hanmi katate dori : Saisie du poignet opposé.
Kata dori : Saisie de l’épaule.
Ryote dori : Saisie des deux poignets.
Ryo kata dori : Saisie des deux épaules.
Katate ryote dori (Morote dori) : Saisie d’un poignet à deux mains.
Hiji dori : Saisie du bras au niveau du coude.
Sode dori : Saisie de la manche au niveau du bras.
Sode guchi dori : Saisie de la manche au niveau du poignet (Le revers de la manche).
Kosa dori : Saisie du poignet homologue (Aï hammi) et atemi au visage avec l’autre main.
Mune dori (Muna dori) : Saisie du kimono au niveau du poitrine.
Eri dori : Saisie du revers du kimono.
Rioerijime : Saisie le col à deux mains croisées (étranglement).
Saisies arrières
Ushiro ryote dori : Saisie arrière des deux poignets.
Ushiro ryo hiji dori : Saisie arrière des deux coudes.
Ushiro Sode dori : Saisie arrière des deux manches au niveau du coude.
Ushiro ryo kata dori : Saisie arrière des épaules.
Ushiro eri dori : Saisie arrière du col.
Ushiro kubi shime dori : Etranglement arrière et saisie d’un poignet.
Ushiro haga hijime : ceinture par derrière au niveau du poitrine.
Saisies par plusieurs personnes
Ninin dori (Futari dori) : Travail avec deux uke qui attaquent en même temps.
Taninzu gake : Prise par plusieurs personnes en même temps.
Ran dori : Travail libre (ran = libre, désordre, dori = saisie).
Attaques
Shomen uchi : Coup sur la tête venant du haut.
Yokomen uchi : Attaque latérale à la tête.
Jodan tsuki : Coup de poing de face au visage.
Chudan tsuki : Coup de poing de face au ventre (au niveau du plexus solaire).
Gedan tsuki : Coup de poing de face niveau bas.
Men uchi : Coup direct au visage avec du tranchant de la main.
Kata dori men uchi : Saisie d’une épaule et men uchi.
Yoko gedan tsuki : Attaque latérale basse en remontant (avec couteau).
Yoko tsuki : Attaque haute du revers du bras.
Coups de pieds
Mae gaeri : Coup de pied de face.
Mawashi gaeri : Coup de pied latéral.
Ura mawashi gaeri : Coup de pied circulaire en revers.
Techniques
Uchi : en entrant sous le bras.
Soto : à l’extérieur du bras).
Ikkyo ( ude osae ) : 1er principe (contrôle du bras par écrasement au niveau du bras).
Nikyo ( kote mawashi ) : 2ème principe (contrôle du poignet par rotation interne).
Sankyo ( kote hineri ) : 3ème principe (contrôle de l’épaule par torsion du poignet).
Yonkyo ( tekubi osae ) : 4ème principe (contrôle point sensible du bord radial du poignet par écrasement de la branche superficielle du nerf radial)
Gokyo ( ude nobashi ) : 5 ème principe (contrôle par élongation du bras).
Projections
Iriminage : Projection avec une main à la nuque et l’autre devant le visage en dessous du menton.
Shihonage : Projection par enroulement du bras de uke en passant dessous.
Kote gaeshi : Projection ou contrôle du bras par rotation externe sur le poignet.
Kaiten nage : Projection en forme de roue, en forme de rotation
Tenchi nage : Projection ciel – terre.
Koshi nage : Projection par la hanche.
Kokyu nage : Projection par la respiration.
Rioerijime kokyu nage : Projection sur une saisie le col à deux mains croisées (étranglement).
Ude kime nage : Projection par action sur le bras au niveau du coude.
Hiji kime osae : clé sur le bras au niveau du coude.
Ude garami : clé de bras en flexion au niveau du coude avec contrôle par les mains
Juji garami : Projection les bras croisés.
Aïki otoshi : Projection en ramassant les jambes (otoshi = renversement).
Ushiro Kiri otoshi : Projection en tirant les épaules vers le bas en arrière.
Sumi otoshi : Projection par une chute de coin.
Aïki nage : Projection en faisant passer uke derrière soi.
Ura nage : Projection en passant le bras au dessus de la tête de uke

Echauffement traditionnel
et préparation physique
et préparation physique
Mitama Shizume (expiration "forcée")
Cet exercice à pour fonction de réunifier le corps et l’esprit avant la pratique. On se déconnecte du monde extérieur pour commencer une unification nécessaire à la pratique. On laisse de côté ses soucis à l’expire et on s’emplit de soi à l’inspire. Mitama Shizume a le sens de : « le dos est chargé du passé éternel, le ventre est chargé du futur. Donc, en étant debout, je développe ma propre conscience, la confirmation de ma propre identité pour accomplir mon destin. » Pour pratiquer cet exercice on se met debout (Maitre Tamura le pratique aujourd’hui en seiza mais l’objectif reste le même) avec les pieds écartés d’un demi pas chacun, les bras le long du corps droit, la colonne vertébrale droite, le menton droit et rentré. Ensuite on expire en se baissant le plus droit possible pour vider peu à peu ses poumons mais surtout son tanden (à 4 cm sous le nombril). Les mains se ferment sur ce mouvement avec le pouce à l'intérieur (on serre les poings) mais sans forcer pour ne pas bloquer le ki (l’énergie). Le poids repose sur l’avant du pied et le périné est contracté. Ensuite on remonte sur l’inspiration pour reprendre la position droite initiale. On pratique ce mouvement 4 fois de suite.
Torifune
C’est une sorte de rameur debout. Ce mouvement symbolise celui réalisé par les âmes des morts pour traverser le fleuve sacré. En aïkido, il sert à éduquer le ki et à le faire circuler dans tout le corps. On est toujours debout les pieds écartés (cf exercice précédent). On regarde vers la gauche tout en avançant le pied gauche. Les bras se tendent à la façon d’un rameur (poings fermés) mais le mouvement doit partir de la hanche. On pousse un « Ei » en se penchant en avant , puis un kiaï « Ho » en revenant à la position d’origine. On réalise cet exercice une dizaine de fois puis on fait des vibrations. Ensuite on passe au côté droit en accèlérant les mouvements d’avancée-reculée et en poussant le kiai « Eï-Sa, Eï-Sa ». On refait les vibrations avant de refaire encore plus rapidement le kiaï « Eï- Eï » sur le pied de départ (gauche).
Furitama
Cet exercice de vibration est un exercice purificatoire shintoïste que l’on pratiquait sous des cascades d’eau (comme celle que l’on trouve à Iwama). On parle de misogi externe On est toujours debout, les pieds distants de la largeur des épaules. On joint les mains (droite par dessus la gauche). Dans le creux formé entre les mains il faut imaginer une boule d’énergie qui doit croître lors du déroulement de l’exercice. On secoue alors ses mains qui sont au niveau du hara de manière à faire vibrer tout le corps. (Des pieds à la tête via la colonne vertébrale). On fait cet exercice en se concentrant sur le “troisième oeil” (c’est à dire entre les sourcils) en alternance avec Torifune. On le réalise donc 3 fois. Remarque : normalement, on doit répéter les mots sacrés qui invoquaient la divinité de la cascade : « Harae-do-no-Okami »
Otakebi
Otekabi consiste, mains à hauteur du front, doigts entrelacés, paumes et doigts vers le bas à pousser le kiai "EI" en resserant et en amenant avec force les mains vers le bas. Le but de cet exercice est d’amener une forme d’autosuggestion qui provoque le rassemblement subit de toute les énergies
Te Kubi Dosa
Assouplissement et renforcement de l’articulation des poignets en exécutant sur soi-même d’abord à gauche (côté du coeur), puis à droite: Ikkyo, Nikkyo, Sankyo et Kote Gaeshi
Tai-No Henka
Mouvements du corps : lkkyo Dosa debout droit, les jambes légèrement écartées, mettez vos mains bien à plat sur votre ventre entre le nombril et le pubis. Dans un état de concentration totale, inspirez, descendez l’air dans votre ventre pour le garder en vous une à deux secondes, puis en avançant la jambe gauche, montez les mains au dessus de votre tête en expirant. Les talons doivent rester collés au sol poussez vers la terre avec la jambe arrière. Le centre Seika Tanden est fort, les doigts sont allongés sans être trop tendus, le rayonnement du Ki, Kinonagare parcourant votre corps pour s’échapper par vos doigts. Le petit doigt en particulier est fort et empli de la puissance du Ki.

Aujourd’hui, notre pratique de l’Aïkido, même si elle est régulière, est beaucoup moins intense, soit entre deux à quatre cours de une ou deux heures par semaine (plus de 4 pour les plus téméraires). Les contraintes horaires ne permettent pas aux enseignants d’assurer une préparation physique avancée durant les cours. Il devient alors important de la faire en plus de notre pratique martiale.
Ashi / Koshi
Kacem Zoughari, expert en histoire des Arts Martiaux Japonais, a expliqué qu’autrefois, on prêtait attention à un élément précis pour estimer la valeur des futurs soldats : Ashi / Koshi, autrement dit, les jambes et les hanches. Parfois, on se contentait même des jambes.
En matière de préparation physique, la musculation des jambes est primordiale. Elles supportent votre corps, sont le garant de votre stabilité en supportant votre poids. Mais surtout, elles sont votre moyen de locomotion. Or, en combat, il faut être mobile.
Si il vous arrive de regarder des affrontements codifiés comme le MMA, vous remarquerez qu’au bout d’un certain nombre de rounds, les combattants baissent leur garde. Certes, c’est une fatigue musculaire qu’il est difficile à gérer. Mais, avez-vous remarqué qu’avant cette baisse de vigilance, ils ont d’abord réduit leurs déplacements ? Pourquoi ? Parce que les membres inférieurs sont de vraies pompes à énergie qui abritent nos muscles les plus gourmands (mais aussi les plus puissants) et c’est pour cela qu’elles perdent rapidement en capacité. Pire encore, lorsqu’on pratique une activité sportive non compétitive, on néglige la musculation des jambes, car ce sont des muscles moins visibles, qui ont moins d’impact social que les pectoraux par exemple.
Alors comment faire pour renforcer vos muscles des jambes ? Il y a bien sûr la façon statique de le faire, comme le propose André Cognard, expert en Aïkido Kobayashi : tenir une posture comme le cavalier pendant un moment, voire un très long moment. Personnellement, je trouve cette méthode intéressante, car elle va améliorer votre capacité à supporter des positions inconfortables, et, si vous pratiquez cela régulièrement et intelligemment, votre fluidité dans le mouvement en sera grandement améliorée.
Cependant je trouve une limite à cela, car on n’y travaille pas l’explosivité, à savoir la capacité de votre muscle mais aussi (et surtout) de vos connexions neuromusculaires de passer de 0 à 100 en une fraction de secondes.
Pour cela, il est intéressant de travailler avec des mouvements dynamiques (par exemple en descendant doucement sur vos squats et en remontant très vite, ou en sautant). Il est aussi extrêmement pertinent de travailler sur la pointe des pieds en focalisant votre attention sur l’utilisation du gros orteil.
De manière très pragmatique, vous pouvez entraîner muscler vos jambes au quotidien, en montant les escaliers. “Il est possible d’utiliser l’immobilité en posture : trente minutes de kiba dachi ou de ritsuzen tous les jours sont une bonne base, à laquelle on peut y ajouter un sabre en jodan (garde haute).”
Le cardio, ou entraînement foncier, indispensable à votre préparation physique
Pourquoi développer son cardio ?
Tout d’abord, si votre capacité cardiaque est très mauvaise, vous ne pourrez pas vraiment profiter des leçons que vous recevez, car vous serez vite essoufflé. Par ailleurs, travailler votre cardio vous permet une meilleure récupération générale. Autrement dit, vous aurez moins de courbatures et de fatigue latente, et vous pourrez vous entraîner plus de fois dans la semaine.
Comment développer votre cardio ?
C’est un travail relativement simple : faites des exercices à intensité modérée mais continue pendant au moins 30 minutes au minimum 2 fois par semaine. Certes, vous pouvez pratiquer la course à pied ou la natation, mais il existe d’autres possibilités. En voici quelques-unes, certainement plus adaptée à la pratique de l’aïkido :
• La corde à sauter : pratique, peu encombrante, vous pouvez l’utiliser un peu partout, en travaillant essentiellement sur la pointe des pieds cela vous permet de travailler les mollets, qui sont très impliqués dans l’explosivité.
• Le sac de frappe : cela permettra de travailler vos attaques et vos déplacements tout en travaillant votre cardio. Voici des idées d’exercices que vous pouvez faire : un mouvement par frappe, utiliser un métronome et faire un mouvement par clic du métronome, faire un nombre de mouvements sur un temps donné.
• tendoku renshu : ce terme est devenu à la mode pendant le confinement. Il s’agit de s’entraîner seul dans le vide comme si vous aviez un partenaire. Une sorte de Shadow Boxing si vous préférez. Attention, pensez à bien visualiser vos mouvements. Vous pouvez utiliser les mêmes astuces qu’au sac de frappe pour vous donner un rythme (métronome, nombre de mouvements sur un temps donné). L’avantage de cette méthode est qu’elle permet d’améliorer votre technique en même temps que vos capacités cardio-vasculaire.
Entre ces exercices vous pouvez inclure des mouvements de renforcement musculaire. Par exemple : 10 séries de 3 minutes de sac de frappe, 30 squats, 30 secondes de pause.
Le renforcement musculaire : deuxième pilier de la préparation physique
La sangle abdominale
Cette sangle peut faire référence au Koshi dont je parlais dans la partie précédente.Comme pour toutes les disciplines qui utilisent l’ensemble du corps et notamment les chaînes musculaires, c’est une zone clé. En effet, elle permet un bon transfert de force entre les parties inférieures et supérieures du corps. Cependant, dans le cadre d’une pratique martiale comme l’Aïkido cela a également un intérêt protecteur. Cette zone musculaire protège la colonne vertébrale qui est une zone extrêmement sensible. De plus, avoir une ceinture pelvienne musclée et souple permet d’éviter ou de limiter les traumatismes lors de certains mouvements (comme les entorses lorsque vous pratiquez de la course à pied).
Comment renforcer cette zone. Le gainage est en premier lieu une bonne solution car :
• il y a peu de risque de blessure en position isométrique
• il peut s’adapter à votre niveau
• il peut être fait n’importe où très facilement
• il y a plusieurs formes de gainage permettant de travailler les muscles dans différents angles (hollow body, planche, etc,..)
Seulement, le gainage comprend certaines limites. D’une part, il conditionne votre corps à rester immobile, ce qui n’est pas très utile car vous souhaitez développer une pratique fluide et en mouvement. D’autre part, lorsque vous avez acquis un certain niveau, il est peu utile de rester 5 minutes en position de planche.
Alors quoi faire ?
Du gainage dynamique ! C’est-à-dire que vous ajoutez du mouvement à votre gainage. Par exemple, lever un bras ou une jambe, ajouter une rotation, etc,.. Cela va ajouter une contrainte et vous obliger à être conscient du travail en chaîne musculaire. En plus de cela vous allez ajouter une notion de proprioception, ce qui n’est jamais une mauvaise idée !
Le renforcement musculaire ciblé
L’entraînement spécifique, c’est le fait d’entraîner spécifiquement quelque chose pour une discipline. Cela est vraiment utile lorsque vous ressentez une faiblesse concernant un mouvement ou un type de mouvement. Par exemple, un manque de puissance dans vos saisies.
En aikido, le corps est mobilisé dans toute sa globalité, c’est pourquoi, la musculation ciblée doit toucher plusieurs zones du corps (sangle abdominale, dos, quadriceps). C’est d’ailleurs pour cela qu’il peut être pertinent d’ajouter en échauffement certains exercices de disciplines comme le crossfit ou la musculation au poids de corps, ou encore le yoga. Si cela correspond aux objectifs pédagogiques du cours bien entendu.
L’alimentation : le carburant de votre corps
Si on fait une analogie entre votre corps et un véhicule, on peut dire que la préparation physique va vous permettre d’avoir un moteur développé et puissant, la préparation mentale va permettre qu’il y ait une bonne lubrification et des durites en bon état (et donc pas de pertes d’énergies) et l’alimentation sera votre carburant.
Savez-vous ce qu’il se passe si vous ne mettez pas le bon carburant ? Parfois rien du tout, le véhicule roule, mais au bout d’un certain temps, le moteur est endommagé. Et parfois, la réaction est immédiate, et vous êtes bon pour voir votre garagiste.
S’alimenter correctement est le moyen le plus fiable de transformer votre corps. C’est avec les nutriments que vous ingurgitez que votre corps se construit. C’est pourquoi, il est essentiel de savoir se composer des repas sains, équilibrés et énergétiques. Si vous vous entraînez beaucoup mais que vous mangez trop vous ne perdrez pas de poids. Si vous ne mangez pas assez, vous ne développerez pas vos muscles.
La régularité : clé d’une bonne préparation physique
Vous voilà motivé, j’en suis certain. Mais avant de vous lancer, sachez qu’il faut du temps pour voir vos efforts payer (que cela soit sur votre silhouette ou sur vos performances), environ 2 mois pour les premiers effets, trois mois pour des effets plus durables. Il va donc falloir vous motiver mais pas seulement.
Mental et rigueur, de puissants alliés
Utilisez votre motivation pour planifier vos entraînements dans votre agenda. De cette manière, il vous sera difficile de trouver une raison pour ne pas les faire. Autant que possible, faites vos entraînements à des heures régulières. Prévoyez vos affaires nécessaires à la pratique en amont de votre entraînement. Tout cela va limiter l’effet de frottement qui nuit à votre motivation. Je vous conseille de placer votre séance de sport en première heure pour deux raisons, plus un bonus :
• vous serez fier de vous toute la journée, ce qui est très bien psychologiquement
• vous n’aurez pas puisé dans votre réservoir à motivation, vous aurez donc plus de mal à abandonner
• (bonus) cela va déteindre sur votre journée et vous rendre plus productif Cependant, cela ne correspondra pas à tout le monde car le corps peut mettre plus de temps à se réveiller, et votre pic d’énergie ne sera pas optimal. Le principal est que vous trouviez l’heure qui vous convienne.
Intégrer le plaisir dans la préparation physique
Un autre élément extrêmement important pour réussir à être régulier, c’est d’éprouver du plaisir.
Voici quelques astuces pour intégrer du plaisir dans votre préparation physique :
• inviter un ami, un enfant, etc. À plusieurs, le moment devient convivial et agréable. C’est d’ailleurs également le cas lorsqu’on se rend dans un dojo, l’ambiance prime souvent sur beaucoup de choses. Car, grâce à l’effet de groupe, on se dépasse et on passe un bon moment.
• Utilisez des outils, variez vos entraînements. Par exemple, n’hésitez pas à employer des élastiques pour faire évoluer vos exercices. Ou, si vous en avez, un TRX ou encore des anneaux. Bref, éclatez-vous !
• N’hésitez pas à vous entraîner en extérieur. Profitez du soleil lorsque c’est possible rend immédiatement l’entraînement plus doux. Sauf en période de canicule !
• Joignez l’utile à l’agréable. Vous devez aller acheter quelque chose au magasin ? Allez-y en vélo ou en courant !
• Utilisez de la musique Les solutions sont multiples, le tout est que cela vous convienne et vous permette de continuer !
Marvin Vega Auteur et co-fondateur de Corps et Esprit Martial
Le tanto
en Aïkido
en Aïkido
Histoire du Tanto
Le Tanto est un sabre court d’environ 30 cm, porté à la ceinture par les Bushis. C’était le complément idéal du long Tachi, dans les combats au corps à corps.
Sur le champ de bataille, le Tanto était parfois utilisé pour tenter de percer l’armure, mais plus généralement pour couper les cordons des protections de l’adversaire, et ensuite être introduit sous l’armure afin de tuer l’ennemi.
Généralement monté sans garde (Tsuba), la garde du Tanto n’était pas tressée, mais recouverte de peau de poisson (Same), laissant les Menuki (décorations) apparentes.
Le Kaiken, est plus petit que le Tanto (15 à 20 cm). Il était utilisé par les femmes des Samouraïs qui le portait dans les manches du kimono. Les femmes s’en servaient pour leur défense rapprochée.
Comme le Katana, le Tanto n’a qu’un seul tranchant.
Technique au Tanto
L’entraînement codifié, (généralement Tanto contre mains nues) est appelé Tanto Dori. Le Tanto est utilisé pour travailler des techniques de désarmement. Au début de la technique, uke cache le Tanto derrière sa cuisse ou sous son keikogi.
Dans la pratique du Tanto dori, où seul uke est armé, les techniques demandent à tori de réagir sur des attaques de type tsuki, shomen ou yokomen avec plus de vigilance que lors des techniques à mains nues. A la fin de la technique, tori doit s’emparer de l’arme, d’où un travail différent, puis le rendre à son uke ou le conserver si c’est son tour de passer uke.
En aïkido, le travail avec un Tanto permet de mieux visualiser un mouvement et de ressentir la technique différemment. Tori doit être d’autant plus vigilant que la lame, même en bois, peut faire mal. Il est également possible à tori d’exécuter certaines techniques armé d’un Tanto. L’intérêt est que l’arme prolonge la main et les éventuelles erreurs sont mieux vues.
Comme pour la pratique des autres armes en aïkido, le Tanto est un outil pour travailler autrement, il ne s’agit pas d’apprendre à combattre au poignard. La maniabilité du Tanto est plus grande que celle du bokken voire du katana. Sa lame le rend toujours dangereux même s’il est moins long qu’un jo.
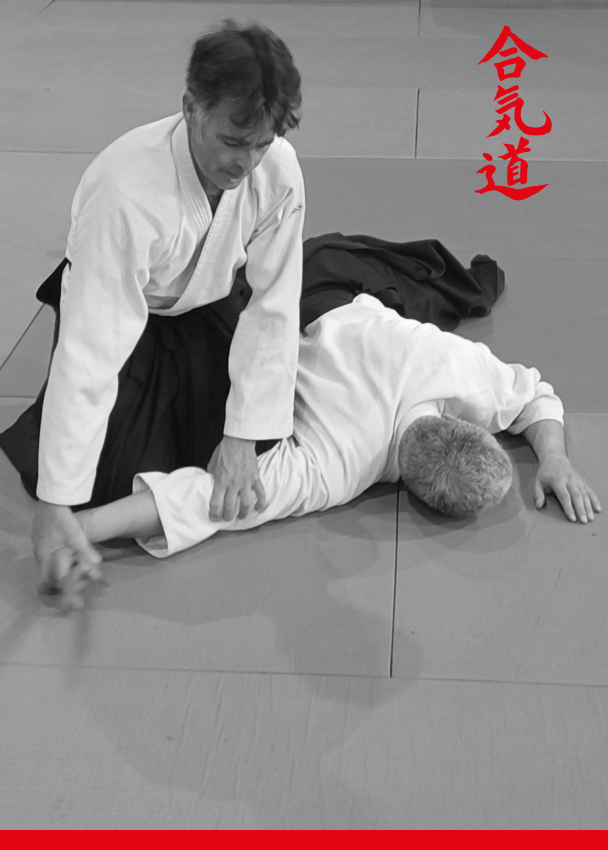
De toutes les armes étudiées en Aïkido, le tanto - le poignard, est la plus actuelle. À ce titre, elle pourrait mériter une attention particulière au sein de l’étude. Cependant, son plus grand intérêt ne réside peut-être pas dans sa probabilité d’occurrence lors d’une altercation, mais dans les qualités qu’elle nous permet de développer.
Relative facilité d’utilisation
La première difficulté à laquelle on doit faire face, est qu’il est relativement facile de provoquer des dégâts avec un couteau. C’est bien entendu le propos de n’importe quelle arme : augmenter le potentiel de dégâts que l’on peut causer. Toutefois, le couteau ne nécessite pas un apprentissage aussi long et complexe que le sabre, le jo, ni même les poings. Cela a pour conséquence qu’un plus grand nombre de personnes peut l’employer et obtenir des résultats morbides. Cela signifie aussi que parmi ces personnes un certain nombre sera totalement imprévisible, puisque non formé à une méthode de combat standardisée. C’est le prototype du débutant qui « attaque mal », mais fait quand même mouche, car il a bougé d’une manière à laquelle on n’aurait jamais songé.
Même manipulé par un néophyte, une attaque au couteau est très rapide. L’arme est petite et se sort rapidement de sa cachette. Des études menées par la police américaine montrent qu’en dessous d’une distance de 6 m, il est plus rapide de sortir une lame et de poignarder un opposant, que de dégainer une arme à feu, d’ajuster le tir et de faire feu…
Cela étant dit, il faut également relativiser cette idée, car bien manier un couteau, cela s’apprend, et l’arme peut également devenir dangereuse pour celui qui l’utilise.
Attaque unique
Cela m’amène à une deuxième considération. L’Aïkido, comme d’autres arts martiaux japonais, semble fonctionner sur un principe d’attaque unique. C’est-à-dire que l’adversaire fournit une seule attaque, censée être définitive, à laquelle on répond par une technique. Ce mode de travail est cohérent : dans le cadre du combat de survie, l’objectif de « l’agresseur » est d’en finir le plus rapidement possible, pas de marquer un certain nombre de points sur plusieurs assauts. Mais cela reste théorique. Dans la réalité, les choses se passent certainement différemment et il peut y avoir plusieurs attaques esquivées -– ou qui font mouche sans être létales - avant que le défenseur ne puisse appliquer une technique.
On peut d’ailleurs voir Morihei Ueshiba démontrer ce genre de travail, en esquivant une première attaque pour appliquer une technique sur une seconde.
Il serait très judicieux de développer ce type d’entraînement - les attaques enchaînées ou répétées - lors de l’étude du couteau. Effectivement, étant donné sa petite taille, le tanto se « réarme » rapidement et on peut asséner plusieurs coups dans un laps de temps très court. Certains experts vont même jusqu’à parler d’« arme de destruction massive », en s’appuyant sur des faits divers aux titres évocateurs : « poignardé de 17 coups de couteau… ». En somme, si le premier coup est manqué le deuxième va arriver très vite.
Il y a donc une double contrainte à satisfaire. L’attaquant doit, à la fois produire une première attaque qui soit décisive, mais également être capable d’en produire une deuxième, puis une troisième si nécessaire. C’est là où les difficultés commencent à apparaître. Puisque certains éléments employés pour rendre la première attaque décisive, peuvent avorter la possibilité d’une seconde attaque.
À titre d’exemple, être fort et enraciné sur une première attaque peut se justifier par le besoin de générer de la puissance, mais entrave la mobilité nécessaire pour générer un second assaut. Est-il possible d’effectuer une attaque décisive sans être enraciné ? Oui, surtout au couteau, mais il s’agit là d’une autre histoire…
Cela fonctionne aussi en sens inverse. À trop penser aux attaques suivantes on effectue mal la première (et cela rend les suivantes difficiles, voire impossibles).
Ainsi, il semble que la mauvaise compréhension de la nature de l’attaque soit source de nombre de difficultés qui ne devraient exister. L’attaque n’existe pas « toute seule dans l’espace », elle fait partie d’un contexte qu’il faut prendre en compte. Il y a un avant et un après. Certains experts d’art chinois expliquent clairement qu’il faut prévoir dix coups d’avance !
L’arme invisible
Au delà de sa facilité d’utilisation, de sa rapidité ou de la répétition des attaques, il me semble que l’aspect le plus caractéristique du tanto soit son « invisibilité »…
Tout d’abord, l’arme peut devenir invisible parce qu’elle est petite. Elle se cache aisément. Certaines écoles de self-defense s’entraînent même à repérer les personnes cachant une arme, le port de cette dernière induisant des tensions ou des mouvements non-naturels perceptibles.
De plus, le tanto peut devenir invisible, parce que celui qui désire l’employer de manière définitive ne le montrera pas de manière ostensible et ne le sortira qu’au dernier moment pour trancher ou planter. Il semblerait ainsi que près de 80% des policiers Américains agressés au couteau n’ont pas vu l’arme.
De la même manière, lorsqu’une lame est montrée rapidement devant les yeux, il est très difficile d’en percevoir la nature et les dimensions, ni même s’il s’agit effectivement d’une arme.
Il y a toujours un couteau quelque part
On pourrait en conclure que puisque le couteau ne se perçoit pas, il est potentiellement toujours là.
On peut ainsi, pour des raisons éminemment pratiques, ne pas l’employer lors de l’entraînement. Dans certains katas de koryu, la lame est simplement symbolisée par le tranchant de la main et c’est suffisant.
Cela fait dire de manière abusive à certains enseignants : « oui mais là je peux te toucher, tu imagines si j’avais une lame ». D’une part, il n’existe pas de technique magique où l’on est certain de ne pas être touché ; faites-en l’expérience avec un boxeur, un pratiquant de Wing Chun ou de Jujitsu Brésilien… D’autre part, la question est plutôt : « quelle puissance de frappe peut-il développer dans sa position actuelle ? » et « combien puis-je encaisser dans ma position actuelle ? ». Même si un couteau intervient, ces réflexions sont valables : toucher une carotide n’est pas la même chose qu’entailler un muscle…
Il est monnaie courante de dire qu’avec ou sans armes les principes ne doivent pas varier. On peut aller plus loin en spécifiant que les sensations corporelles ne doivent pas varier non plus. On devrait avoir autant peur si l’opposant est armé que s’il est désarmé, pour la simple et bonne raison qu’on ne sait pas s’il a une arme ou non.
Saisir l’intention
Pour autant, invisible ne signifie pas inexistant. Difficilement perceptible ne signifie pas imperceptible. Pour percevoir ce qui semble imperceptible, il faut observer précisément ce qui se passe une étape plus tôt. En ce qui nous concerne, il faut lire l’intention d’attaque en amont. Mais pour pouvoir lire cette intention de trancher il faut qu’elle existe ! Et cela aussi est un véritable travail ! Il faut réussir à faire « comme si » on voulait vraiment trancher l’autre. Il ne s’agit pas juste de faire une « attaque sincère » (qui souvent est juste un peu plus forte et rapide), mais de donner à son partenaire la sensation qu’il va vraiment être coupé s’il ne bouge pas. C’est difficile. C’est difficile à main nues, alors on emploie un tanto en bois pour nous aider à cristalliser notre intention. Mais même avec un tanto cela peut être difficile. Lorsque l’on sort un cutter, généralement la donne change. L’intérêt de l’outil est donc de nous aider à orienter notre intention plus précisément. À terme plus besoin d’outil…
Vers plus d’intensité
Ainsi, le tanto nous permet de faire ressortir les réactions instinctives de survie et nous plonge dans un état de présence d’un autre monde. À ce moment-là, l’Aïkido n’est plus une danse chorégraphiée. Paradoxalement cela devient plus beau. Car c’est plus intense. Intense ne signifie pas nécessairement plus rapide, plus violent ou plus fort. Cela signifie juste que nous mettons « plus de nous » dans l’action. Il me semble que c’est à partir de ce point-là que l’Aïkido peut commencer à tenir ses promesses d’efficacité martiale et spirituelle.
En sortir indemne
Cela m’amène à ma dernière considération sur le sujet. On dit que lorsque deux tigres s’affrontent, l’un est tué, l’autre blessé. Affronter un adversaire de niveau équivalent signifie nécessairement qu’il y aura des pertes, qu’on n’en sortira pas indemne. Cela est d’autant plus prégnant dans le cadre de l’affrontement au tanto. Lors d’une attaque au couteau, il y a de fortes chances que les deux protagonistes soient touchés. En prendre conscience me semble capital pour une pratique saine de l’Aïkido. Les pratiquants d’Aïkido sont souvent enfermés par l’image d’invincibilité du Fondateur. Tant mieux si Morihei Ueshiba était un adepte hors du commun. Cela doit être motivant. Mais cela ne doit pas nous amener à penser que parce que nous pratiquons « ses » techniques nous sommes potentiellement invincibles. C’est la quantité et la qualité d’entraînement pour une technique qui la rendent efficace, non des principes magiques que ne connaîtrait qu’une élite favorisée par le ciel.
Ainsi, le couteau offre de véritables difficultés qui peuvent parfois sembler insurmontables au point de causer une rétractation du type : « de toutes façons face à un couteau je n’ai aucune chance, donc inutile de l’étudier ». Cela peut être sage, mais c’est aussi dommage, car si l’arme est dangereuse, cela signifie qu’elle est un formidable levier de progression.
Epilogue : vers l’invisible
Comme évoqué avec le tanto, l’invisibilité est source de grandes difficultés. Le couteau semble surgir de nulle part et c’est pour cela qu’il est difficile de l’éviter. Mais si l’on part à la recherche de la cause de son apparition (l’intention émise par l’opposant) un formidable champ d’étude s’offre à nous.
De la même manière, le praticien de Shiatsu cherche la cause, voire la cause de la cause, de l’affection de son patient. Il ne s’agit pas de traiter juste le symptôme, il s’agit d’aller chercher ce qui l’a provoqué. Très souvent la cause est cachée, difficilement perceptible. Cela doit amener le praticien à affiner ses qualités de perception. Il s’agit d’observer de simples choses qui peuvent dire beaucoup : le rythme respiratoire, le mouvement des yeux, la posture, etc. Il s’agit là d’éléments du diagnostic qui sont tangibles, même s’ils semblent parfois insignifiants. Il existe également des niveaux de perception « supérieurs » où l’information arrive de manière plus soudaine. Une intuition de diagnostic, le désir de toucher une zone plus qu’une autre, l’impression que le déséquilibre est dû à tel élément… Finalement c’est en commençant à regarder avec sérieux les petits détails visibles que l’on arrive à percevoir des phénomènes apparemment invisibles.
Germain Chamot
Cet article est paru dans Dragon Spécial Aïkido n°14
Ikkyo
le premier principe en Aïkido
le premier principe en Aïkido
Cette technique est considérée comme la plus basique de toutes les techniques d’aïkido et devrait être possible à réaliser sur n’importe quelle attaque. Elle est également une technique d’entrée pour nikyo, sankyo, yonkyo, gokyo et hijikime osae.

Shomen
Shite : tout en avançant d’un pas, Shite attaque de face, visant la tête de Uke (Shomen), avec son Tegatana droit, et porte un coup au flanc de Uke avec le poing gauche
Uke : Uke reçoit le Tegatana droit de Shite avec son bras droit
Shite : Dans le mouvement de coupe vers le bas et devant l’épaule – du bras avec lequel Uke a bloqué le Tegatana droit de Shite- Shite saisit le poignet de Uke et contrôle son coude avec la main gauche. Ensuite, il avance son pied gauche vers le pied droit et amène le bras droit de Uke vers le bas et devant lui (Shite) enfin, il avance encore pour amener le bras de Uke au sol. Shite se déplace ensuite vers la droite pour coincer le bras de Uke entre ses jambes et frappe à la tête avec le Tegatana droit.
Notes :
vous devez attaquer le premier en coordonnant le mouvement des jambes et des bras. Lorsque vous bloquez votre ennemi au sol, faites attention à bien positionner son bras dans un angle droit par rapport à son corps.
Questions posées par le journaliste :
1- Quelle est l’importance de cette technique ?
2- Quels sont les points les plus importants dans l’exécution de cette
technique ?
3- Quelles erreurs les débutants ont-ils tendance à faire ? Quels pièges
attendent les plus avancés ?
4- Avez-vous quelques conseils à donner pour progresser dans cette technique ?
5- Avez-vous quelque chose d’autre à dire sur cette technique ou sur l’Aïkido en
général ?
Seiseki Abe Sensei
Aïkikai 8ème Dan
Dojo Ameno Takemusu Aiki Juku
1- Cette technique est importante car elle est la base pour Irimi, les Atemi et les mouvements des bras et des jambes en Aïki.
2- Attention à bien renforcer votre Ki, qui émane de votre Hara et de votre Tegatana.
3- Attention à bien déplacer les bras, les jambes et les hanches en harmonie. Il est important de déplacer votre Hara, votre Seichushin (ligne centrale du corps) et vos hanches souplement et rapidement dans un mouvement de spirale.
4- Concentrez correctement votre Ki dans votre Hara et étendez vos épaules, coudes, bras et poignets. En d’autres termes, laissez l’énergie couler à travers eux et c’est cette puissance qui les fera se mouvoir instantanément.
5- Pour cela, vous devez avoir une posture naturelle face à votre adversaire. Concentrez votre Ki (Kokyu et Hara) et votre esprit (tête et Hara) et votre corps (bras, jambes et hanches) et fortifiez-les tous (Kokyu-ryoku).
Ikkusai Iwata Sensei
Aïkikai 9ème Dan
Dojo Aikikai Ichinomiya Shibu
1- Cette technique est la plus importante et la plus difficile de toutes les techniques d’Aïkido. Pourquoi ? Parce que dans cette technique, nous devons maîtriser notre partenaire sans lui faire mal. Dans les techniques de base de Nikyo à Gokyo, nous avons le dessus en attaquant ses points faibles. Mais dans Ikkyo, nous ne le faisons pas. Ikkyo est la technique la plus importante, celle qui nous aide à apprendre l’harmonie dans le temps et l’espace, la fusion de votre Kokyu avec celui de votre adversaire, fusion et harmonie dans les mouvements et déplacements circulaires, l’ajustement et la coordination des mouvements des bras et jambes, et le mouvement du Ki, esprit et corps ne formant qu’un. Cette technique ne doit pas être négligée, car elle est importante pour atteindre les buts de l’Aïkido. Vous ne devez pas focaliser votre attention que sur les formes, vous ne devez pas non plus pratiquer un entraînement de connivence avec votre partenaire. Il est important de suivre à la lettre les principes et les règles de l’art, et de vous dévouer entièrement et régulièrement à votre entraînement.
2- Toute chose a son Omote et son Ura. Ces deux aspects sont le résultat de deux approches différentes quant au processus des mouvements circulaires.Dans Ikkyo Omote, vous attaquez votre adversaire durant ce laps de temps très court pendant lequel il lève la main pour vous frapper. Dans Ura, vous répondez à son attaque après que sa main soit complètement descendue en bas. Le mouvement en Omote et Ura pour Ikkyo est très très court, en d’autres termes, il est très rapide. Il vous faut donc être capable d’agir très vite. Il est important de vous déplacer très rapidement, tout en gardant l’harmonie des mouvements des bras et des jambes, ainsi que la coordination dans l’équilibre des appuis supérieurs et inférieurs du corps. Cependant, il ne faut pas vous focaliser sur la vitesse, et négliger ainsi la précision. Ayez un mouvement correct et approprié.
3- Cette technique peut sembler très facile aux yeux du débutant. Il ne doit cependant pas la négliger. Les plus avancés ne doivent pas commettre la même erreur. Ils doivent toujours l’exécuter avec sérieux sans aucun préjugé de facilité. Voici les vérités et les règles de tous les aspects de la vie.
4- Si vous continuez votre poursuite de cet art sans relâche et sans négliger l’approche des techniques, vous découvrirez alors l’essence véritable de cet art. Vous trouverez aussi de nouveaux indices qui vous aideront à progresser.
Kenji Shimizu Sensei
Dirigeant du Tendokan
Dojo Tendoryu Aïkido Tendokan
1- Ikkyo est aussi la base de Nikyo, Sankyo et Yonkyo. En Aïkido, votre respiration et le timing entre les deux adversaires sont les points les plus importants et Ikkyo vous permet d’acquérir le Kokyu en Omote et Ura. Il est donc nécessaire de vous entraîner et de perfectionner cette technique plus que les autres.
2- L’objectif principal de la pratique de cette technique est la maîtrise du timing et de la réaction découlant de la rencontre entre deux adversaires. Il vous faut donc être assez vigilant pour ne pas laisser votre adversaire voir votre ouverture, et observer chacun de ses mouvements afin de ne pas réagir en retard.
3- Pour les débutants : au début, ils ont tendance à n’utiliser que les bras pour amener l’adversaire au sol et pour l’immobiliser, et ce sans comprendre la signification de Omote et de Ura. Il faut le corriger avant que cela ne devienne une mauvaise habitude qui aurait un impact négatif sur les autres techniques. Il est important d’exécuter les techniques plusieurs fois – et correctement à chaque fois, pour les maîtriser et pour apprendre à se déplacer rapidement.
Pour les plus avancés : dans un art non compétitif comme c’est le cas de l’Aïkido, nous avons tendance à oublier le sérieux de notre pratique et devenons habitués à des techniques pré-arrangées. Si nous nous concentrons uniquement sur la forme, nous risquons d’oublier la signification de l’Aïkido en tant que Budo.
4- Il est primordial de pratiquer en gardant un esprit sérieux, appliqué, et ce même quand vous exécutez une technique au ralenti ou lentement. Je pense que ce conseil vous aidera à progresser.
Katsuyuki Kondo Sensei
Soke Dairi Daito-ryu Aïkijujutsu
Dojo Shinbukan
1- Cette technique fait partie des secrets de l’art du daito-ryu et sert à contrer une attaque de sabre avec les mains nues. C’est une technique de base importante qui peut prouver que les techniques du Daito-ryu ont été transmises depuis le temps des guerres civiles jusqu’à nos jours. Dans notre école, Ikkajo ne constitue pas une seule technique, mais consiste en une trentaine de techniques qui incluent dix techniques idori, cinq techniques hanza handachi, dix techniques tachiai, cinq techniques ushirodori. L’une d’entre elles s’appelle ippondori.
2- Il faut focaliser sur le travail du déséquilibre dans l’exécution en Omote et Ura (étude de l’Aïki).
3- Puisque l’on suppose que le Tegatana de l’adversaire est une épée, vous devez éviter qu’il vous touche à la tête. Les pratiquants avancés doivent travailler sur le maai (distance) dans un combat sabre-mains nues.
4- Vous devez être capable d’apprécier et de juger correctement le metsuke, le kokyu, le maai et le Yin et Yang. Vous devez aussi être capable d’utiliser le aiki dans l’exécution de vos techniques. Ainsi, vous aurez un entraînement de base en arts martiaux suffisant.
Le kamae
la garde en Aïkido
la garde en Aïkido
Il peut sembler étonnant dans une discipline martiale comme l’Aïkido qui veut tendre vers la liberté, la spontanéité et le naturel, de parler d’une garde initiale, donc du kamae. Le kamae ou garde d’entrée est, par définition même, une posture très marquée, conventionnelle et statique.
L’idéal en Aïkido, ne serait-il pas justement de ne pas en avoir de garde et d’être toujours prêt ? Et que dire d’une posture préparatoire lorsque l’attaque, de quelque nature qu’elle soit, s’effectue en totale surprise ?
Et pourtant il existe au moins un Kamae de base en Aïkido dans la pratique à mains nues. Et de nombreux Kamae sont répertoriés en Aïki-ken et Aïki-jo.
Le Kamae idéal doit répondre à 2 exigences fondamentales : réduire sensiblement la surface corporelle présentée à un adversaire potentiel, et permettre un déplacement rapide autant vers l’avant que vers l’arrière et que latéralement. C’est en conséquence la position de 3 / 4 qui est adoptée classiquement en Aïkido avec le poids du corps réparti à égalité sur chaque pied. Les pieds sont peu ouverts, on parle d’écartement des « épaules » et si la garde est avec un Hanmi (positionnement) avec le pied droit devant, le gauche est en position légèrement ouverte derrière le droit. Le grand orteil droit forme avec le talon du pied gauche et la pointe du pied gauche un triangle dirigé vers l’opposant. Cette position particulière des pieds est caractérisée de « San Kakuro ».
C’est cette position qui est supposée permettre de se déplacer de façon quasi immédiate dans presque toutes les directions. Cette exigence de ne pas déterminer à priori une direction pour l’esquive ou le pas d’entrée, conditionne aussi un assez faible écartement des pieds d’où un transport facile du poids d’un pied à l’autre. Ici, très clairement, plus les pieds sont écartés, plus on est stable, certes, mais plus il sera difficile d’amorcer certains déplacements. Par contre et bien que la posture de base en Aïkido à mains nues suppose un poids réparti à égalité sur chaque pied, si le Kamae doit précéder une entrée directe type Irimi, il est alors indispensable de mettre plus de poids sur le pied avant. Typiquement, celui-ci s’ouvre alors un peu dans le cas d’une entrée directe pour réaliser IRIMI NAGE.
Concernant le haut du corps, autrefois les mains étaient ouvertes et dirigées vers l’avant ; c’était véritablement un Kamae très marqué. Très vite, ce positionnement des mains est devenu plus discret pour tendre vers une posture très naturelle où les bras et mains sont le long du corps. On parle alors de Mu Kamae et ce malgré la position du corps qui reste de 3 / 4. Le caractère Mu en japonais (Wu en Chinois) est un privatif qui est utilisé aussi en négation simple :
Mu Kamae peut se traduire par « sans Kamae apparent ». Plusieurs méthodes d’auto-défense actuelles préconisent une absence complète de posture d’entrée. Cela parce qu’une garde d’entrée est déjà une provocation vis-à-vis d’éventuels et potentiels agresseurs. Mais, de plus, cette « prise de Kamae » bien visible, renseigne les opposants sur le caractère entrainé ou expérimenté de celui qui l’effectue. C’est donc tactiquement assez défavorable dans une situation conflictuelle réelle.
En Aïkiken
C’est dans la pratique du Ken que l’on trouve historiquement le plus de Kamae. Cela en fonction des écoles et des situations propres aux combats avec sabres.
Trois niveaux de garde sont distingués.
Au niveau bas, sous la ceinture, Gedan Kamae . Le Ken ouvert, tenu à 2 mains, pointe vers le bas et vers l’extérieur droit.
Au niveau intermédiaire (Ventre, poitrine) c’est la garde Chudan Kamae aussi appelée « Seïgan ». C’est la plus répandue. Le Ken est devant soi, tenu à 2 mains, pointant vers les yeux de l’opposant qui est supposé avoir également un sabre.
Au niveau haut : Jo Dan Kamae : garde haute, typiquement au-dessus de la tête, Ken toujours tenu à 2 mains.
De nombreuses autres gardes sont utiles et très pratiquées : Haso Kamae, Waki kamae, etc. Dans la pratique habituelle en Ken Taï Ken avec Nishio Sensei, celui-ci préconisait une posture caractérisée de Mu-Kamae avec le Ken tenu à une main, la droite bien sûr, les bras le long du corps le Ken pointant alors la ligne médiane entre les 2 pieds. Son caractère simple et naturel ne préjugeait en rien la capacité de réagir contre tout type d’attaque au sabre d’un adversaire en coupe ou piqué. Mais l’élément constant, quels que soient l’école ou le style, c’est la répartition du poids sur les pieds : dès l’instant où l’on a un Ken ou un katana dans les mains, le poids du corps est mis au moins pour ses 2 / 3 sur le pied avant, marquant ainsi le caractère résolument offensif de la situation. Le talon gauche est donc très légèrement levé. Et pour le rendre encore plus clair, la position des pieds de San Kakuro (position triangulaire où un pied est derrière l’autre) est abandonné dans la plupart des Kamae (sauf Waki Kamae) pour une position où les 2 pieds sont un peu plus fermés et presque sur les lignes parallèles.
En Aïki-jo
C’est là où les pratiquants d’Aïkido, qui se sont attachés à suivre l’enseignement de Nishio Sensei ont eu le plus de changements à réaliser.
Un Kamae au Jo très classiquement mis en œuvre avant l’arrivée de Nishio Sensei, consistait à tenir le Jo de la main droite, verticalement posé au sol devant soi. L’intérêt était surtout pédagogique. La situation était très claire. Mais Nishio Sensei tenait cette posture pour erronée : elle permettait de montrer immédiatement à son opposant la longueur du Jo.
Erreur fatale, sûrement autrefois. Mais, de nos jours, où tous les Jo ont la longueur standard de 1 mètre 28, on pouvait se demander ce qui restait à cacher. Malgré cela il n’était pas question d’utiliser cette garde avec Nishio Sensei. Venant du monde du Jo Do, la pratique généralisée en Aïkido du Jo Taï Jo lui était indifférente. Il ne l’a jamais enseigné. Seul le travail en Jo Taï Ken , donc bâton contre sabre se pratiquait avec lui . Et là il fallait prendre à chaque fois des gardes très naturelles et riches de possibilités.
Deux Kamae au Jo étaient particulièrement utilisées par Nishio Sensei.
Elles se plaçaient toutes deux au niveau Chu Dan avec comme objectif de cacher la longueur du Jo, donc avec un Jo dirigé vers les yeux de l’opposant. La première s’effectue pied droit devant, avec le Jo à gauche, tenu au milieu avec la main gauche et les 2 doigts (index et majeur) de la main droite cachant la section du Jo.
L’autre se fait aussi avec pied droit devant mais le Jo est à droite, tenu en son milieu cette fois par la main droite et orienté de façon très précise vers l’œil gauche de Uké. Si Uké ferme son œil droit il ne voit que la section du Jo sans en appréhender la longueur.
Cette précision sur l’orientation vers l’œil gauche rappelle une fois encore le rôle différent joué par les 2 hémisphères du cerveau, celui de droite commandant le côté gauche et inversement. Ce n’est pas aussi simple, loin s’en faut pour les yeux. Mais la précision de positionnement était très importante. Avec le Jo ainsi positionné, Nishio sensei considérait que l’opposant, avec un sabre, ne pouvait pas attaquer. L’ouverture du Jo seule, ne fut-ce que de 2 ou 3 cm, permettait à Uké d’amorcer son attaque.

Lorsque des armes, telles qu’un Boken ou qu’un Jo et a fortiori un Katana sont en œuvre, l’intention de celui qui a l’arme à la main est claire et le Kamae prend tout son sens. C’est déjà un peu moins vrai dans le cas de l’utilisation du couteau, qui peut-être souvent caché jusqu’au dernier moment.
Mais dans un contexte à mains nues, ce qui est le plus gênant dans la mise en place d’un Kamae, c’est l’immobilité même fugitive qu’il suppose. Dans une situation un tant soit peu réelle, une telle attitude aussi marquée, est révélatrice d’intentions, et simultanément de capacités de défense ou de combat. C’est donc techniquement contre-productif.
À mains nues la mise en place d’un Kamae ne se justifie facilement que dans le cadre d’une démonstration, entre autre pour l’aspect pédagogique.
Dans un contexte plus normal, voire de réel conflit, un Kamae risque, si on n’y prend garde, de focaliser l’attention sur cette posture de celui qui s’y complait. Le Kamae semble ainsi même s’opposer à la mise en place de l’état d’esprit réellement nécessaire : celui d’une vigilance extrême.
En effet, plus important que le Kamae du corps, doit être en définitive le Kamaé de l’esprit, ou la posture mentale. Et celle-ci est facile à résumer : c’est la vigilance, l’attention, la présence parfaite ici et maintenant. Cela suppose une présence totale, qu’on caractérise aussi de « pleine conscience ».
Cette conscience aigüe de l’instant présent, dont Nakazono Sensei nous parlait longuement dès les années 60, le Naka Ima (ici et maintenant), doit nous permettre de mieux appréhender le flux continu changeant de tout ce qui nous entoure. Il ne s’agit pas d’être particulièrement rapide ou d’avoir des réflexes très affutés, mais être simplement en totale harmonie ou connexion avec tout ce qui nous entoure donc aussi avec notre éventuel opposant.
C’est dans cette posture mentale très particulière et pourtant naturelle, caractérisée aussi de MUSHIN, l’esprit sans fixation, que toutes les disciplines martiales japonaises révèlent leur profonde connexion avec le Zen.
Le Zen, son esprit, sa pratique, supposent que l’on soit en parfaite harmonie avec la vie, sans vouloir ni l’arrêter, ni la saisir, ni interrompre son développement.
Cette attitude mentale particulière de prise en compte directe du flux de la vie, sans l’intermédiaire d’images, de concepts ou de formes figées est ce qui caractérise l’état de Mushin. Celui-ci est aussi très proche du concept taoïste Chinois de Wu-Wei (« Non-action » littéralement). Il imprègne tous les arts martiaux et a trouvé son expression la plus haute dans l’escrime et les arts du sabre : Iaïdo, Kendo, Ken-Jutsu, etc.
Cette attitude mentale, le Mushin, est fortement connectée à la garde appelée Mu-Kamae. Celle -ci est en effet supposée permettre une relaxation physique, un lâcher prise au niveau du corps. Et ce relâchement à son tour favorise la concentration mentale, la disponibilité complète du corps et de l’esprit, ici et maintenant, à l’écoute et en totale connexion avec l’environnement donc avec l’adversaire.
Ainsi quand il faudra parer ou attaquer ou simplement esquiver en bougeant, ce ne sera pas sur une réaction réflexe mais une action en totale harmonie avec le geste de son opposant sans aucun décalage de temps.
La réponse à l’évènement doit être immédiate et spontanée, donc sans l’intervention d’une opération mentale d’analyse et de calcul. Cette mise en application des principes du Zen dans l’art du sabre a été longuement commentée par le moine Takuan Soho (16° siècle) : « Lorsqu’on tape dans ses mains, le son se dégage immédiatement. Le son n’attend ni ne pense avant de sortir. Il n’y a aucun état intermédiaire, un mouvement succède à un autre, sans l’intervention du mental conscient….. Que votre défense suive l’attaque sans intervalle et il n’y aura pas deux mouvements séparés appelés attaque et défense. ».
Le Kamae parfait est le Mu-Kamae : il n’est pas visible, il est simplicité et relâchement au niveau physique mais présence et conscience aiguë de l’instant présent pour ce qui est de l’esprit. Il est la pure expression du Zen dans l’art martial qu’est l’Aïkido.
Paul Muller

Les bienfaits
de l'Aïkido
de l'Aïkido

Envie de vous initier au self-défense tout en douceur à l'Aïkido Quimper ? L'Aïkido constitue une très bonne méthode ! Ses techniques défensives prônant la non-violence font de plus en plus d'adeptes en France. Zoom sur l'art martial japonais qui cartonne dans le monde.
L’histoire de cette discipline martiale, sa genèse, sa philosophie sont accessibles dans de nombreux articles. Je voulais ici insister plus largement sur les apports que peut apporter la pratique de l’aïkido. Notamment sur les actions sur les points de la trilogie Corps Cœur Esprit.
L’aïkido fait partie des arts martiaux japonais en tant que discipline complète, source de bien-être pour le corps et l’esprit. C’est également une méthode de connaissance de soi. Nul besoin de faire partie des sportifs de haut niveau pour le pratiquer. Homme ou femme, enfant ou adulte, jeune ou senior, chacun peut trouver dans sa pratique un bénéfice personnel. La raison tient en l’essence même de l’aïkido : l’éviction totale de la violence, qui fait de lui le plus doux des arts martiaux. Les contre-indications médicales de ce fait sont rares, et cela est dû à la grande capacité d’adaptation de la pratique de l’Aïkido. L’absence de compétition permet de débuter à tout âge et de faire évoluer sa pratique à très long terme. Vous apprenez à vous reconnecter à votre corps, par le biais de l’apprentissage de mouvements aux actions positives immédiates sur tout votre organisme.
Je vais développer ces différentes contributions sous forme d’un “Shiho nage”, c’est à dire autour de quatre directions : la technique bien sûr, mais aussi le corporel, les valeurs morales, et sociales.
Apports Physiques en Aïkido
L’aïkido n’est pas un sport, l’esprit de compétition étant exclu. Une activité physique certaine y est cependant bien présente et va produire de nombreux bienfaits.
Sur les articulations
Nos activités quotidiennes derrière un bureau ou un volant, sources de gestes répétitifs et de mauvaises postures, nous imposent des positions fragilisant nos articulations. En aïkido, les échauffements et le travail des techniques permettent de mobiliser en douceur les différentes articulations. L’effet sera d’entretenir la souplesse articulaire, et bien souvent d’améliorer l’amplitude des articulations. L’aïkido impose un travail articulaire. Le travail à différents niveaux, en alternant les positions debout et au sol fréquemment, assouplit et renforce les jambes. La stimulation des membres inférieurs apporte par là une meilleure stabilité et une plus grande mobilité du bassin (qui abrite le centre de gravité de l’homme en un point appelé Seika Tanden ou Hara en aïkido). Progressivement, le pratiquant améliorera sa résistance aux contraintes sur ses articulations, en augmentera leur souplesse, en particulier au niveau des épaules, des poignets et des chevilles.
Sur la colonne vertébrale
Grâce au travail en souplesse, l’aïkido permet de relâcher les tensions nerveuses et musculaires du dos. L’amélioration posturale du corps est la clé de la qualité technique. Par le travail sur une posture juste de la colonne vertébrale, le corps va reprendre petit à petit une position convenable. L’aïkido vous permettra d’amplifier souplesse et mobilité de la colonne vertébrale. Au point que certaines douleurs peuvent disparaître grâce à ce rééquilibrage postural.
Sur les organes internes
Les différents mouvements et techniques pratiqués mobilisent les organes internes (comme le coeur et les poumons). L’aïkido est d’une grande efficacité sur le système cardio-vasculaire et amène chacun de nous à son plus haut niveau, souvent oublié, grâce à une progressivité de la pratique. Le coeur fournit un effort de moyenne intensité sur une période prolongée. Le redressement du tronc par la pratique permet une meilleure respiration, plus profonde. Les rythmes pendant les temps de pratique sont variables, conduisant le corps à une grande capacité d’adaptation aux variations d’intensité. Finalement, vous assistez à une augmentation de vos capacités respiratoires.
Sur la chaîne musculaire
L’aïkido peut vous permettre d’accepter les contraintes physiques de la vie moderne en toute sérénité. La pratique régulière permet à la fois de renforcer le maintien entre les muscles et la structure osseuse, tout en améliorant la souplesse. Chaque muscle est sollicité harmonieusement en profondeur et en globalité. Par exemple, le dos, les fessiers, la ceinture abdominale, les cuisses sont mieux gainés, et se renforcent. Votre corps gagne en tonicité et votre masse musculaire augmente.
Le travail des techniques
L’équilibre et le déséquilibre
Les techniques étudient le déséquilibre du partenaire tout en conservant son propre équilibre dans le cadre d’une mobilité. Ensuite, les techniques sont effectuées de manière dynamique, sur un rythme modéré. Ainsi, l’objectif est de canaliser et contrôler le partenaire sans affrontement. Ainsi, par cette pratique, l’aïkido développe les réflexes et écarte les appréhensions.
La coordination physique et mentale
L’aïkido est basé sur le principe de non-opposition, qui s’étudie à mains nues ou avec armes. Le but n’est pas la destruction de l’autre, mais le contrôle physique et mental de l’agression et de son auteur. Pour cela, il faut abandonner la peur paralysante pour accepter cette “attaque”. La concentration apporte le précision dans les gestes, et développe les capacités de réflexion et de prise de décision. La pratique amplifie l’attention et la vigilance, l’affirmation de soi. Ceci est d’ailleurs très bénéfique aux enfants, car ils n’ont comme adversaire qu’eux même : l’absence de compétition écarte toute idée de gagnant ou de perdant. Indirectement, une action s’exerce sur l’équilibre psychique : il permet de retrouver un équilibre et une paix intérieure. Les exercices de respiration libèrent les tension et aboutissent à un mieux-être.
La maîtrise de soi
La pratique des techniques s’effectue en réponse à différentes formes d’attaques. Ainsi, corps et mental s’habituent au stress d’une attaque, à la réponse appropriée à y apporter (principe de légitime défense).
Le fait de rouler et chuter au sol améliore le contrôle de soi et les sensations que nous pouvons avoir lors de l’apparition d’un déséquilibre qui conduit à la chute. La peur de la chute disparaît. Enfin, se contrôler amène un équilibre général, et la confiance en soi revient.
La Coordination des mouvements et la gestion de l’espace
En aïkido, tous les mouvements se font à droite et à gauche, en faisant appel à l’ensemble de la chaîne musculaire. Ainsi, réflexes, équilibre et coordination trouvent une amélioration notable. Aussi, chez l’enfant, c’est l’ensemble de la psychomotricité qui est stimulée : la complexité des placements lui apporte des situations qui influent directement sur sa structure corporelle, ses sollicitations musculaires, et sa coordination.
Chez le pratiquant confirmé, certaines techniques s’étudient avec plusieurs partenaires. De telle sorte que la précision des déplacements et la rapidité d’évaluation des distances affinent plus encore la perception spatiale du corps.
La sérénité morale
Premièrement, la pratique répond à une “éthique”, qui permet une déconnexion avec l’environnement quotidien. Puis le lieu de pratique (dojo), tenue de travail (keikogi), terminologie employée, règles du dojo, sont autant d’antidotes au stress de la vie quotidienne. Ainsi, de nombreux pratiquants rapportent une rapide évolution de leurs difficultés d’endormissement ou de troubles du sommeil. Ensuite, la pratique avec un partenaire (et non un adversaire) avec comme moteur le relâchement apporte un équilibre psychologique, qui permet de retrouver une meilleure qualité de vie.
Puis les effets des mouvements et techniques, des assouplissements, de la respiration, se prolongent en dehors du dojo. De telle sorte que c’est la santé et le bien-être quotidien qui se retrouvent ainsi bénéficiaires des temps de pratique. Enfin, nous (ré)apprenons à nous ressourcer, à nous retrouver et nous rendre disponibles aux autres.
Valeurs sociales et morales de l’Aïkido
Lors de conflits
D’abord, l’aïkido met l’accent sur l’inter-relation avec l’autre. En effet, sérénité et valeurs humaines permettent de transposer une agression physique aux attaques verbales. Puis l’aïkido peut permettre de résorber, voire annuler des conflits.
Lors de relations humaines
La perception de l’autre comme partenaire conduit le pratiquant à cultiver des relations humaines équilibrées et vertueuses. C’est pourquoi appliquer les situations de “combat” à la résorption d’actions négatives en se protégeant sans blesser l’autre affine le travail sur soi au quotidien.
Valeurs morales
L’aïkido est un Budo. Donc le respect du Bushido (code d’honneur du samouraï) s’y rattache . Sa pratique permet de développer des valeurs morales telles que politesse, ainsi que la modestie, bonté, loyauté, fidélité, honneur, courage et parfaite maîtrise de soi. Ainsi, ces notions importantes, transmises aux enfants et adolescents, leur permet une canalisation de leur énergie. La pratique permet aussi une maîtrise émotionnelle et une capacité de concentration décuplée.
Conclusion
L’aïkido, que nous pratiquons à l'Aïkido Quimper, est donc un art martial qui permet à la fois un mieux être physique et un équilibre moral durables dans le temps. Cette philosophie de vie et ces bénéfices se retrouveront dans vos vies personnelle et professionnelle. car les pratiques sont transposables à l’extérieur du dojo de l'Aïkido Quimper, dans tout autre contexte.
D’abord la compétition place l’enfant puis l’adulte en opposition avec les autres conduit à la dévalorisation lorsqu’il pense ne pas être le meilleur. Puis, l’aïkido, oblitérant cette notion, replace l’individu au centre de sa construction avec l’autre.
Pourtant, la liste des bienfaits que je viens de faire n’est pas exhaustive. Car chaque individu fera son propre constat dans sa vie quotidienne et des multiples bienfaits qui en découlent. Dans beaucoup d’activités sportives, vous ne pouvez pratiquer que quelques années avant d’être sur la touche. Au contraire, l’Aïkido c’est une évolution de toute une vie. Ainsi, vous pouvez le pratiquer toute votre vie, en ayant toujours le sentiment de pouvoir progresser, tout en restant naturel. Vous sentirez votre squelette de plus en plus solide. Ayant appris à chuter, vous éviterez sans doute plus tard maintes fractures. Vous reconnecter à votre être tout entier est très simplement possible, que vous soyez homme, femme, de 7 à 97 ans.

Les grades
et la progression technique
et la progression technique
En aïkido, nous n'avons que 2 couleurs de ceinture (la blanche et la noire), mais nous avons des grades qui existent même si ils ne se manifestent pas par une ceinture de couleur.
Les grades kyus
Quand on débute l'aïkido, on a le grade de 6ème kyu. Puis, au fur et à mesure que l'on progresse, on passe les grades de 5ème kyu, 4ème kyu, et ainsi de suite en décroissant jusqu'au 1er kyu. Tous les grades kyus correspondent à une ceinture de couleur blanche, mais si on voulait à tout prix faire un parallèle avec des ceintures de couleur comme il en existe ailleurs (par exemple en judo ou en karaté), on pourrait dire que :
le 5ème kyu correspond à peu près à la ceinture jaune
le 4ème kyu correspond à peu près à la ceinture orange
le 3ème kyu correspond à peu près à la ceinture verte
le 2ème kyu correspond à peu près à la ceinture bleue
lle 1 er kyu correspond à peu près à la ceinture marron
Les grades kyus se passent dans les clubs. Ce sont les professeurs qui décernent les grades, souvent lors d'un examen de "passage de grade", ou alors en constatant (même sans organiser un passage de grade) que l'élève a progressé et qu'il a atteint le niveau correspondant au grade du dessus.
Les grades dan
Après le 1er kyu, ce sont des grades "dan". C'est d'abord le 1er dan, puis le 2 ème dan, puis le 3ème dan et ainsi de suite de façon croissante.
Les grades dan ne se passent plus dans le club, mais devant un jury composé de plusieurs personnes lors de passages de grades organisés par la ligue, ou par la fédération française d'aïkido. Les grades dan sont matérialisés par le port de la ceinture noire.
Les grades du 1er au 4ème dan sont des grades techniques qui sont décernés à l’issue d’un examen (assez rarement sur dossier), les grades au dessus du 4ème dan sont systématiquement décernés sur dossier. Ils sont parfois "honorifiques" et ne correspondent pas toujours (mais souvent quand même) à un niveau technique supérieur.
Le hakama
Le port du hakama est autorisé à partir du moment où l'aïkidoka a franchi un certain niveau. Ce « certain niveau » dans les différents clubs, ou les différentes fédérations, n'est pas toujours le même, mais ceci n'est pas très important.
Souvent dans nos clubs (et en tous cas c'est le cas chez nous), le hakama se porte à partir du 2ème kyu (mais j'ai connu un club ou c'était à partir du 1er dan ...).
Le rythme de la progression :
Je me garderai bien, ici, de définir ce qui pourrait être un rythme « normal » pour la progression sur l’échelle des grades. En effet, nous n’avons pas tous le même âge, pas tous la même souplesse, nous ne pratiquons pas tous avec la même intensité, nous ne progressons pas tous à la même vitesse etc. .... Pourquoi alors y aurait-il une échelle de temps dite « normale » pour passer d’un niveau au niveau immédiatement supérieur ? La vérité est qu’il n’y a pas de normalité en ce domaine.
De même, on ne peut pas considérer comme étant automatique et normal le fait de pouvoir présenter un examen à un grade supérieur au bout de x mois ou années de pratique depuis l’obtention du grade précédent.
Ce qui est certain, en revanche, c’est qu’il faut plusieurs années de pratique avant de pouvoir se présenter au grade de ceinture noire 1er dan.
Les référentiels des niveaux attendus :
Pour les grades kyus
A chaque début d’année, les nouveaux licenciés reçoivent de la part de la fédération française d’aïkido un « guide du débutant ». 3 Ceux qui ne sont pas nouveaux licenciés (ou ceux qui ont perdu le guide) peuvent le télécharger sur le site internet du club. Dans ce document, entre autres choses, il est proposé quelques « exemples de progression pour les grades kyus ». Cela peut donner une bonne base, de révision pour l’élève, et d’évaluation de grades kyus pour le professeur.
Mais comme je viens de le dire, ce ne sont que des exemples, ce n’est qu’une base qui a le mérite d’exister mais qui reste assez imparfaite. D’abord, parce que cette « liste de techniques » ne comprend pas toutes les techniques, certaines pourtant intéressantes à travailler n’y figurant pas. Ensuite car ce n’est pas parce que l’élève a oublié ou a exécuté imparfaitement une technique demandée, ou en a exécuté une autre par erreur, qu’il ne mériterait pas le grade correspondant et qu’il n’en aurait pas le niveau. Au professeur, donc, d’évaluer le niveau, plus ou moins à partir de cette grille, selon des critères qui peuvent être un peu subjectifs et qui en tous cas ne figurent pas dans cette grille. Dur métier…
Au-delà de la grille d’évaluation ci-dessus, il me semble très important que l’élève qui se présente à un examen de grade kyu puisse démontrer qu’il a évolué, dans sa « forme de corps » et dans sa pratique, par rapport au grade précédent. Les éléments observables, qui peuvent démontrer cette évolution dans la pratique, sont nombreux. Par exemple, le rythme donné (moins hésitant, plus dynamique), la fluidité des déplacements, le placement, des attitudes plus claires et plus lisibles, la façon dont le déséquilibre du partenaire a été construit, la martialité, l’engagement des hanches, la juste anticipation, l’équilibre dans la projection du partenaire, le respect du centrage, le regard, le respect des intégrités de Uké 4 et de Tori, et bien d’autres encore, sont des attitudes corporelles observables qui peuvent démontrer que l’élève a franchi un palier et qu’il peut prétendre à un grade supérieur (même s’il n’est pas capable d’exécuter toutes les techniques demandées au grade kyu en question).
Pour les grades dan
Pour les grades de ceintures noires, c’est je trouve plus compliqué et peut-être un peu plus subjectif. Toutefois, on peut dire que :
Pour le 1er dan, le candidat devra démonter qu’il connaît toutes les techniques (connaissance de l’enveloppe corporelle générale des mouvements demandés). Cette démonstration devra présenter des critères corporels observables, tels que la façon dont les mouvements sont construits (entrée, création et conduite du déséquilibre, amenée au sol ou projection), le respect de l’intégrité (de soi même, du partenaire).
Pour le 2ème dan, le candidat devra démontrer qu’il maîtrise toutes les techniques, avec une plus grande compétence, davantage de rapidité, d’engagement physique et de puissance qu’au 1er dan. L’attitude, le placement, la mobilité et l’anticipation seront autant de compétences à mobiliser pour cette démonstration.
Pour le 3ème dan, le candidat devra démontrer sa capacité à s’adapter à diverses situations, à maîtriser son partenaire. La maîtrise des techniques doit être plus complète, elles doivent s’exprimer avec davantage de finesse, de précision et d’efficacité qu’au 2ème dan. Une certaine liberté dans l’application des techniques peut également commencer à émerger. C’est le début de la compréhension du kokyu ryoku (coordination de la puissance physique et du rythme respiratoire). L’entrée dans la dimension spirituelle de l’Aïkido : la finesse, la précision et l’efficacité technique commencent à se manifester. Il devient possible de transmettre ces qualités. Une expression de puissance et d’efficacité technique doit se manifester. C’est un Aïkido dynamique où commence à transparaître le début d’un relâchement corporel. Le candidat fait preuve de disponibilité, maîtrise et contrôle ; il sait s’adapter à l’action d’Aïté. Il sait aussi démontrer des variations sur les techniques. Les appuis sont plus légers (pas d’ancrage dans le sol). Les déplacements tendent à être plus courts et plus précis (maaï et irimi tenkan mieux maîtrisés). Le travail du sabre manifeste une meilleure maîtrise du shisei et du kamae. La disponibilité dont fait preuve Tori se retrouve aussi dans les ukémis de Aïté dans une recherche d’harmonie.
Pour le 4ème dan, à ce niveau techniquement avancé on commence à entrevoir les principes qui régissent les techniques. Il devient possible de conduire plus précisément les pratiquants sur la voie tracée par le fondateur. Les fondamentaux commencent à être exprimés librement. Le candidat montre sa faculté à anticiper ou à créer les situations. L’attitude générale exprime le contrôle de soi et du partenaire. Les appuis sont légers, mobiles et le relâchement du corps commence à être observable. Une plus grande liberté et plus d’aisance s’expriment dans la pratique avec les armes .

Je pense que les passages de grades sont importants, peut-être même essentiels, mais ils ne sont pas indispensables. Ci-dessous les principales raisons, à mon avis, pour lesquelles ils sont importants :
S’étalonner par rapport à une échelle de valeurs : nous pratiquons une discipline dans laquelle il n'y a pas de compétition, ni de confrontation directe avec un partenaire. De plus, notre progression technique ne s’évalue pas à l’aide d’une mesure objective (avec un chronomètre, par exemple), ni par notre capacité à franchir une difficulté objective (comme en ski, ou en escalade par exemple). Dans le cas de l’aïkido donc, les grades sont les seuls moyens de jalonner notre progression, et d’en prendre conscience.
Progresser : un grade n’est pas facile à obtenir, et on doit travailler avec persévérance pour atteindre le niveau requis. Cet objectif de grade qu’on peut se donner, par exemple en début de saison, et les moyens qu’on met pour y arriver (par exemple en pratiquant de façon intensive et assidue) nous font à coup sûr progresser dans notre pratique. La préparation aux grades est un accélérateur de progression !
Gérer le stress : dans la vie, de nombreuses sources de stress existent. Et dans une situation conflictuelle ou agressive que l’on peut vivre, le stress peut vite augmenter 5 et nous conduire à des attitudes non appropriées et que l’on pourrait regretter par la suite (comme par exemple des attitudes de paralysie, de fuite, ou encore de surenchère dans l’agressivité etc. …). Se soumettre à un examen de grade, qu’il soit dans le club (pour les grades kyus) ou en dehors du club (pour les grades dan), peut être source d’un petit stress. Il n’est pas inintéressant d’apprendre à gérer ce stress, même s’il reste limité et modeste, et de s’en faire un allié plutôt qu’un ennemi…
Se faire plaisir : le fait que le grade obtenu n’ait pas été facile à obtenir le rend sans doute plus appréciable. De plus, je pense que le plaisir à pratiquer l’aïkido est intimement lié à la progression technique. Plus je progresse, plus mon plaisir est grand, et plus mon plaisir est grand plus je progresse. Ceci peut être vrai dans de nombreuses autres disciplines d’ailleurs, qu’elles soient sportives, artistiques (par exemple la musique) ou autres. Et comme préparer un grade me fait progresser, je me donne ainsi les moyens d’augmenter mon plaisir à pratiquer.
Les limites et les inconvénients des passages de grades :
Pour certaines personnes, le passage de grade représente peu d’intérêt dans leur pratique. Le stress évoqué précédemment, même s’il est modeste, peut les bloquer et leur enlever tout plaisir. L’examen peut également leur rappeler des souvenirs scolaires ou étudiants pas forcément heureux. Ne pas vouloir « se mettre la pression », vouloir pratiquer avec plaisir sans rechercher la « performance » sont des positions très légitimes et tout à fait respectables. C’est pourquoi les grades ne sont pas indispensables à une pratique sereine et heureuse.
Pour les passages de grades dan, nous passons l’examen en dehors du club, avec des partenaires qu’on ne connait pas forcément, parfois qui ont des pratiques légèrement différentes des nôtres ce qui peut à minima nous perturber, ou au pire nous faire réaliser une prestation en deçà de ce qu’on produit d’habitude. La déception est parfois au rendez-vous !
La sanction de l’examen (réussite ou échec) n’est pas toujours représentative du niveau réel du candidat. Certains candidats échouent alors qu’ils ont le niveau, d’autres réussissent alors qu’ils ne l’ont pas (mais heureusement, la plupart des réussites sont méritées, et la plupart des échecs également). Ceci est surtout vrai lors des passages de grades dan où les jurys ne connaissent pas forcément les candidats, à l’inverse de ce qui se passe en club pour les grades kyus où le professeur est censé connaître le niveau des élèves qu’il évalue. En effet, le candidat n’a que 15 ou 20 minutes maximum pour montrer ce qu’il sait faire, et de nombreux paramètres externes peuvent influencer positivement ou négativement sa prestation du moment : le stress, le fait de pratiquer avec des partenaires qui ont une pratique différente, l’heure de la journée, une fatigue ou une baisse de forme passagère, la difficulté à comprendre les mouvements demandés par les jurys qui ne prononcent pas toujours les mots japonais comme on en a l’habitude etc. …
La gestion d’un échec :
Vouloir se soumettre à un examen de grade, c’est accepter au préalable la possibilité d’un échec.
L’échec peut bien entendu être très positif : en vertu du principe que « tout ce qui ne tue pas rend plus fort », l’échec va nous aider à comprendre pourquoi ça n’a pas « fonctionné », va nous obliger à faire un travail sur nous même, à nous remettre en question et sans doute à parfaire encore notre technique. Et la réussite, la fois d’après, n’en sera que plus savoureuse ! Enfin, l’échec renforcera sans doute notre humilité, ce qui ne peut jamais faire de mal …
Mais l’échec peut aussi entraîner des émotions négatives : découragement (tout ce travail préparatoire pour rien …), ou sentiment d’injustice surtout si on pensait avoir le niveau. Bien penser à relativiser la portée et les conséquences de l’échec. Ce n’est que de l’aïkido, que nous pratiquons pour notre plaisir, rien de plus …
La préparation, l’assiduité, la persévérance :
Pour progresser en aïkido, il n’y a malheureusement pas de secret, il faut pratiquer, encore, encore et encore. Tout comme le musicien répète sans cesse ses gammes et les morceaux qu’il travaille, il nous faut pratiquer avec assiduité jusqu’à ce que notre corps reproduise les mouvements sans qu’on y réfléchisse, de façon quasi « automatique ».
Quand on apprend à conduire une voiture, par exemple, il faut penser à tout, et à tout en même temps : débrayer, accélérer, enlever le frein à main, mettre le clignotant, regarder dans le rétroviseur, et bien sûr avoir au coin de l’œil le piéton qui s’apprête à traverser devant nous en dehors du passage piétons. Et bien d’autres choses encore ! C’est difficile, au début nous n’y arrivons pas, et heureusement parfois le moniteur est là pour freiner à notre place … On peut avoir tendance à se décourager d’ailleurs, devant la difficulté. Et un jour, miracle ! A force de persévérance et d’entraînement, on y arrive. Et à force de pratique, ça nous paraît même facile, tellement facile qu’on ne comprend pas pourquoi, avant, on n’y arrivait pas …
L’aïkido, c’est pareil, sauf que c’est plus difficile que de conduire une voiture. Mais heureusement, ça procure nettement plus de plaisir (et ça pollue nettement moins …). Donc l’apprentissage est plus long. Mais ce n’est pas une corvée, bien au contraire c’est un plaisir ! Comme je l’ai dit plus haut, plus on pratique, plus on progresse, et plus on progresse plus on prend du plaisir.
Pour ce qui concerne le rythme, je pense que :
À pratiquer une fois par semaine en moyenne, les progrès sont lents, voire parfois décourageants.
Si on pratique environ une fois par semaine en moyenne, on peut progresser au départ assez vite, mais on va voir la progression ralentir ou stagner au bout de quelques grades kyus.
Sans doute au milieu des grades kyus (plus ou moins vers le niveau hakama), il va falloir pratiquer plusieurs fois par semaine pour continuer à progresser de façon significative et franchir un palier.
Et quand on s’approche des grades dan, il est nécessaire de s’astreindre à une pratique plus régulière et plus assidue encore, et de se « frotter » à d’autres partenaires que ceux du club. Les stages, les interclubs et autres cours intensifs sont des occasions à ne pas rater.
Enfin, si on vise des grades dan de haut niveau, la pratique doit devenir quasi quotidienne. Ça devient un mode de vie, une pratique quasiment professionnelle.
Bien entendu, l’échelle de corrélation entre l’assiduité et la progression, proposée ci-dessus, n’est qu’une estimation personnelle issue de ma modeste expérience et de quelques unes de mes observations, mais n’est pas une vérité absolue. On pourra facilement trouver nombre de contre-exemples qui viendront contre-dire cette échelle, dans un sens ou dans l’autre.
Il est évident que nous avons tous des activités autres que la pratique de l’aïkido, qui elles aussi sont prenantes (des activités scolaires, professionnelles, familiales, etc. …). L’aïkido vient en plus de toutes ces activités. A chacun alors de trouver le bon compromis, le bon équilibre entre toutes ces activités, et de consacrer à l’aïkido le temps juste, qu’il estime équilibré, utile à sa progression et à son plaisir.
Les passages de grades kyus au sein du club :
Pour moi, il y a 2 conditions pour qu’un élève puisse se présenter à un passage de grade kyu :
Qu’il en ait envie :
comme dit plus haut, nous pratiquons une activité de loisir, qui est censée nous apporter du plaisir, de la sérénité, de la maîtrise de soi, un mieux être physique et mental et plein d’autres bienfaits encore. Si le fait de se présenter à un examen atténue ou dégrade ces bienfaits, alors il ne faut pas le faire …
Que le(s) professeur(s) estime(nt) que l’élève est prêt, dans l’objectif d’éviter un échec qui n’est jamais agréable à vivre (ni pour l’élève, ni pour le(s) professeur(s) qui « refuse(nt) » le grade à l’issue de l’examen).
L’élève peut être à l’initiative de la demande, qu’il formule auprès de son professeur et qui la valide (ou pas …). Ca peut être aussi le professeur qui est à l’initiative, et qui suggère à son élève qu’il pourrait prétendre à un grade supérieur, charge à l’élève alors d’accepter (ou pas …) la proposition.
Les passages de grade peuvent avoir lieu tout au long de l’année, mais pour des raisons pratiques il est plus simple de les organiser en 2 fois : une fois au milieu de l’année (vers décembre / janvier), une autre vers à la fin de l’année (vers mai / juin).
Les examens prennent la forme d’une démonstration de l’élève, avec quelques techniques imposées et d’autres libres.
Yannick VIGNERON

Le suwari waza
les techniques au sol
les techniques au sol
Justification
Historiquement, les japonais vivent au sol, s'asseyant par terre. Assis signifie en fait à genoux, dans la position dite seiza lorsque le dessus du pied est au sol ou keiza lorsque l'on s'appuie sur les orteils. Les fesses et le poids du corps reposent alors sur les talons, un genou en avant, les deux cuisses formant un angle proche de 40°. Les pieds peuvent être à plat au départ des techniques, mais l'essentiel du travail se fait avec les pieds dressés sur les orteils. C'est donc logiquement que les samouraïs développèrent des techniques partant de cette position, afin d'être capables d'attaquer ou de se défendre en toute situation. De nos jours, en aïkido, la pratique à genoux permet de travailler le renforcement des jambes (souplesse, musculature), ainsi que la posture (shisei). En effet, comme on ne peut plus se servir de ses jambes pour « passer en force », cette posture impose d'avoir un mouvement juste. Il convient cependant d'être prudent dans le travail à genoux, car il sollicite beaucoup les ligaments. Il faut donc faire attention à poser doucement ses genoux, et garder le poids du corps sur les talons. Le port d'un hakama en matière synthétique ou en soie facilite énormément ce travail, grâce à une moindre friction sur les tatami à couverture plastique et en offrant aux genoux une protection supplémentaire.
Déplacement
Le déplacement de base se nomme shikkō. On part d'une position à genoux, les fesses posées sur les talons et en appui sur les orteils (keiza) : on lève le genou droit en posant le pied à plat au sol, ce qui fait avancer le pied ; le pied gauche suit le pied droit pour rester « uni » à lui, il y a donc un pivot sur le genou gauche ; puis on avance le genou gauche tout en reposant le genou droit au sol ; à la fin du mouvement, on est à nouveau en keiza. On recommence ensuite de l'autre côté. Un autre déplacement fondamental consiste à lever le genou droit en posant le pied à plat, puis à faire glisser le genou gauche tout en reposant le genou droit au sol ; à la fin du mouvement, on est à nouveau en keiza. Le pivot sur place se fait en partant les genoux écartés : pour un pivot à droite : on rapproche le genou gauche du genou droit en se levant sur les genoux ; on pivote d'un demi-tour, les genoux serrés ; on écarte le genou droit en se rasseyant sur les talons.
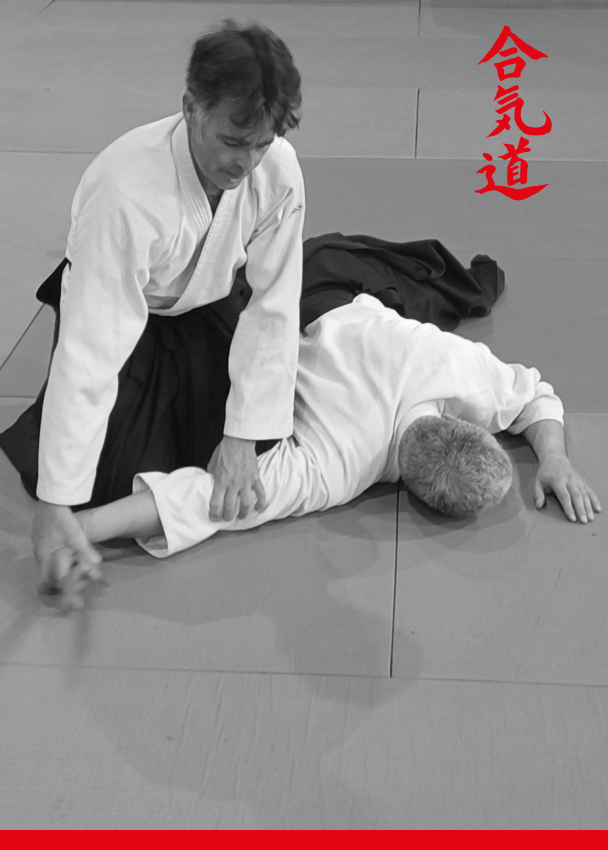
Les mythes associés au suwari waza
Pour les défenseurs de la tradition comme ses opposants, le Suwari Waza est régulièrement perçu comme un vestige du passé, un élément traditionnel issu d’une culture dans laquelle la position agenouillée est habituelle. Les gardiens du temple souhaitant donc évidemment garder ce travail, alors que les pratiquants défenseurs d’une pratique qui évolue avec son temps auront tendance à lui trouver moins de crédit à une époque où la chaise est dominante. Je ne me considère personnellement pas comme traditionaliste, et j’ai du mal à accepter que l’on puisse faire les choses pour une simple question de tradition. En revanche, il me semble essentiel de regarder plus en profondeur si les éléments que nous percevons comme de simples vestiges d’une tradition passée n’ont pas originellement été établis pour des raisons beaucoup plus profondes, et dans le cas qui nous intéresse si le Suwari Waza ne permet pas de développer certaines qualités utiles dans la pratique de l’Aïkido.
Parmi les nombreuses justifications de l’emploi du Suwari Waza, le renforcement des jambes et des hanches est l’une des plus courantes. Là encore, cette explication est relativement limitée: comment est-ce que la pratique à genoux contribue-t-elle à renforcer les jambes et les hanches? N’y a-t-il pas de méthodes plus efficaces tout en étant moins dangereuses pour les genoux? Le simple fait que nombre d’Aïkidoka aient des problèmes de genoux après plusieurs années de pratique m’a toujours laissé songeur.
Une troisième explication régulièrement entendue est que le travail à genoux serait une préparation au Ne Waza. Argument dangereux à mon avis, je connais peu d’Aïkidoka qui s’en sortiraient honorablement aux sol face à un pratiquant même peu avancé de Jiu Jitsu Brésilien…
Le Suwari Waza, plus facile pour les japonais ?
S’il est souvent entendu que la difficulté à tenir le Seiza et à pratiquer le Suwari Waza est essentiellement due à des différences corporelles entre les japonais et les non-japonais, il est important de noter que même parmi les japonais, les avis ne sont pas convergents. Parmi eux, Gaku Homma, qui fut l’un des derniers Uchi-Deshi d’Osensei et enseigne aux Etats Unis, a la particularité de ne plus enseigner Suwari Waza à ses élèves, considérant que cette pratique est plus néfaste que bénéfique. Dans un article écrit il y a une dizaine d’années, il se montre particulièrement critique.
« En tant que pratiquant actif d’arts martiaux, je souhaite évoquer dans cet article le problème des "genoux". Chez les Aïkidoka en particulier, les genoux sont la partie du corps qui a subi le plus de dommages et qui a causé le plus de problèmes à beaucoup. Lors de mes voyages dans différents pays à travers le monde, je rencontre constamment des gens qui ne peuvent plus s’asseoir en seiza et qui portent des genouillères à cause de problèmes de genoux liés à leur pratique de l’Aïkido. J’ai rencontré des élèves dont les genoux étaient si abimés qu’ils ne pouvaient plus les plier, et encore moins s’asseoir en seiza. »
« Les problèmes de genoux ne sont pas l’apanage des non-japonais. Il y a eu des Aikidoka haut gradés japonais célèbres, vivant au Japon et à l’étranger souffrant de problèmes de genoux durant leur carrière. C’est une chose de développer des problèmes aux genoux avec l’âge, mais de nombreux enseignants d’Aïkido ont développé ces problèmes via la pratique abusive du suwari waza… et ils avaient pourtant l’avantage d’un héritage culturel les préparant à la pratique. »
La question de la physiologie est ici clairement remise en cause, mais on notera cependant que Gaku Homma critique plus particulièrement une pratique à genoux excessive. A cela j’ajouterai deux éléments. Le premier est le type de mouvement réalisé en Suwari Waza: si la pratique à genoux est présente dans de nombreuses Koryu, c’est seulement en Aïkido que l’on retrouve de grands mouvements circulaires dans cette position. Le plus souvent dans les anciennes écoles de Jujutsu, les mouvements au sol sont particulièrement restreints. Le deuxième élément est l’épaisseur et la mollesse des tatami: les Koryu ne pratiquaient pas forcément sur tatami, et lorsqu’elles le faisaient elles utilisaient des tatami autrement plus durs que ceux que nous utilisons aujourd’hui. Si ces tatamis modernes rendent les chutes moins dévastatrices, ils ont aussi pour conséquence de permettre à l’articulation du genou de s’enfoncer. Les grands mouvements circulaires appliqués dans ces conditions peuvent donc avoir des conséquences fâcheuses si le genou se retrouve coincé pendant la rotation. A fortiori si le poids du corps tombe dans les genoux, ce qui est une erreur courante.
Gaku Homma ajoute que les enseignants japonais des années 60 et 70 qui partaient enseigner à l’étranger, recevaient des consignes particulières : « Rappelez-vous que nombre des nouveaux élèves que vous aurez seront plus forts que vous physiquement. Les techniques en suwari waza seront difficiles pour eux, donc les pratiquer vous donnera un avantage en dépit de votre différence de taille. Pour avoir un plus grand contrôle sur vos élèves, pratiquez le suwari waza. Et pendant les examens, si vous testez des élèves que vous n’appréciez pas particulièrement, faites les passer en dernier, et faites les attendre leur tour en seiza.»
Simplifier l’apprentissage pour les débutants
Pourtant, malgré toutes ces critiques, si le travail à genoux est présent en Aïkido ainsi que dans de nombreuses écoles anciennes, il est évident qu’il doit avoir une utilité réelle. Parmi elles, je crois que la simplification de l’apprentissage pour les débutants est la plus évidente.
Les techniques d’Aïkido nécessitent une bonne synchronisation générale. Le haut et le bas du corps doivent pouvoir travailler correctement ensemble, alors que Tori doit s’appliquer à s’harmoniser à l’attaque de son partenaire et realiser un mouvement respectant un grand nombre de critères techniques. Sans une excellente coordination de base, c’est particulièrement difficile, voire frustrant pour un débutant.
Si j’ai personnellement longtemps détesté le Suwari Waza pour les douleurs aux genoux qu’il m’occasionnait, j’y ai trouvé un réel intérêt pédagogique en particulier avec mes élèves les moins à l’aise avec leur corps. Pour Tori, le travail à genoux permet de ne pas avoir à se préoccuper de la connexion entre le haut et le bas du corps, les jambes ayant un rôle désormais limité et les hanches se plaçant correctement beaucoup plus naturellement. Se faisant il devient plus simple de se concentrer uniquement sur le haut du corps, et le mouvement des mains. De même les réactions possibles du partenaire étant limitées, le travail ne s’en retrouve que simplifié d’avantage. Mais c’est également une simplification utile pour un débutant prenant le rôle d’Uke et qui se retrouve à devoir chuter d’une position beaucoup plus basse et donc moins effrayante.
Améliorer sa mobilité
Il y a quelques années lors d’un stage, Akuzawa sensei nous expliquait qu’au Sagawa dojo il était courant de pratiquer Age Te (Suwari Waza Kokyu Ho) pendant trois heures d’affilée. S’il ne semblait pas particulièrement enthousiasmé par l’idée, il remarquait cependant que les débutants ressentaient de vives douleurs, notamment aux chevilles et aux genoux, et avaient du mal à garder la position pendant plus de quelques minutes. Il notait en revanche que les avancés avaient développé une grande mobilité dans leurs articulations et en particulier au niveau des hanches. Il est important de noter qu’il ne s’agissait pas d’une mobilité de type « Shikko » avec de grands mouvements circulaires qui ont tendance à abimer les genoux plus qu’autre chose.
En augmentant notre mobilité articulaire, nous augmentons l’espace disponible dans notre corps, permettant d’une part de bouger plus facilement avec moins de tensions, et d’autre part d’avoir plus d’espace pour absorber les forces transmises par notre partenaire. Il suffit d’ailleurs de regarder les vidéos du fondateur de l’Aïkido pour reconnaitre l’importance d’un corps mobile.
S’il existe de nombreux moyens plus rapides et plus efficaces pour renforcer la puissance des hanches ou pour approcher le Ne Waza, le travail à genoux me semble être une des rares pratiques qui puisse permettre d’augmenter considérablement sa mobilité. En revanche, pour atteindre cette mobilité, il me semble également nécessaire de s’avoir s’éloigner de la forme technique elle-même pour s’approcher d’un travail plus ludique, permettant de libérer les tensions. Ce travail lui-même ne nécessite pas forcément de partenaire et il peut simplement s’agir de mouvements simples en partie d’une position Seiza: effectuer une transition de Seiza à Zazen par exemple, ou d’une position agenouillée à un position debout - ou l’inverse - sans pousser dans le sol avec les jambes.
L’Aïkido est un système complet, et cohérent même si certaines parties peuvent parfois nous sembler étranges, obsolètes ou inefficaces. Les manques que nous percevons ne sont pourtant pas les manques de l’Aïkido lui-même mais bien ceux de notre pratique. Si nous n’y trouvons pas de sens, c’est peut être tout simplement que quelque part, nous sommes passés à côté.
Article de Xavier Duval, publié dans Dragon Magazine
Le reishiki
étiquette et cérémonial
étiquette et cérémonial
Dans la culture japonaise, l’étiquette est d’une importance rare, on la retrouve naturellement de façon prépondérante dans les arts martiaux traditionnels tel que l’Aïkido.
Le Reishiki est composé des idéogrammes «rei» qui signifie vénérer, respecter, saluer et de «shiki», qui correspond à cérémonie, rite, style, forme.
Reishiki pourrait donc se traduire par «Cérémonial», mais c’est bien plus encore…
A l’Aïkido Quimper, dans notre dojo, nous encourageons les pratiquants à respecter le lieu, le kamiza, les partenaires et être attentif à tous les mouvements lors des entraînements.
Plus généralement, entrer dans un dojo, c’est pénétrer dans un monde à part. Le dojo est un lieu pour étudier l’Aïkido avec pour finalité purifier et élever son corps et son esprit pour la réalisation de soi-même. Le Reishiki est un élément indispensable pour y parvenir.
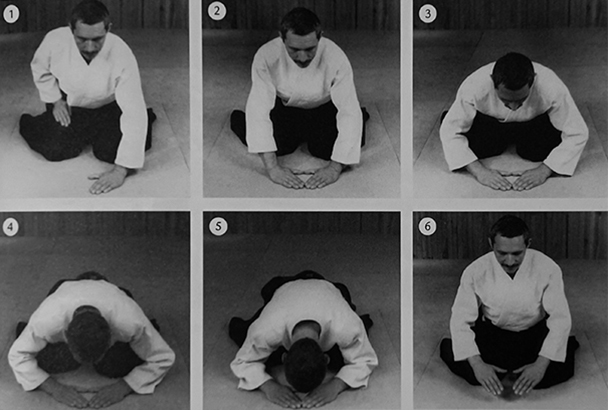
Le Reishiki peut varier suivant les dojos, mais on observe une base élémentaire commune.
Dès l’entrée du dojo
En entrant et en quittant le dojo, s’opère un salut debout en direction du mur où se trouve le portrait d’O’Sensei (shinden)
Le respect
Le respect des partenaires commencera par une propreté corporelle, et un Gi propre et en bon état. On porte uniquement un gi, et on n’utilise que les armes qui nous appartiennent.
Les armes
Rangées, prêtes à servir, le long du tapis, les armes ne doivent jamais être enjambées. Tout comme le gi, elles ne peuvent servir qu’à celui à qui ils appartiennent.
Au début du cours
En montant sur le tatami, les zoori sont rangés tournés vers l’extérieur en évitant de tourner le dos au shinden. Puis, on salue en seiza (position assise) en direction du shinden, avant de rejoindre sa place en attendant le début du cours.
Tout au long du cours
Il convient d’éviter de s’entraîner devant le shinden. Dans tous les cas, on ne doit pas s’asseoir devant lui en lui tournant le dos, même le cours terminé.
Le cours commence et s’achève par un salut formel. Il est indispensable de se présenter à l’heure pour y participer. En cas de retard, l’élève devra attendre debout au bord du tatami (en principe au centre, face au shinden) et patienter jusqu’à ce que le sensei l’autorise à se joindre au cours.
Enfin, la position à adopter sur le tapis est la position seiza. Allonger les jambes, s’adosser à un mur ou un poteau n’est pas admis. A chaque instant, nous devons être disponible.
le respect vis à vis du Senseï (le professeur)
Lorsque le sensei montre une technique, les élèves restent assis en seiza et attentifs aux explications. Dès la fin de la démonstration, vous saluez le sensei, puis votre partenaire, et commencez à travailler. Si le sensei vous apporte des corrections ou des précisions, mettez vous en seiza et restez attentif à ses explications. Saluez le lorsqu’il a terminé. Un arrêt du travail est également admis pour porter attention à une explication fournie par le sensei à un autre pratiquant. Dans ce cas, la position seiza est également de mise, ainsi que le salut lorsque l’éclaircissement a été apporté. Si vous devez poser une question au sensei, vous le saluez et attendez qu’il soit disponible ; il n’est pas convenable de l’appeler.
Dès que le sensei annonce la fin d’une technique, vous saluez votre partenaire et rejoignez les autres pratiquants (assis en ligne).
Eléments implicites du Reishiki
Pour commencer : parler le moins possible sur le tatami !
L’étude est de mise, aucun pratiquant n’est présent pour imposer ses idées aux autres : l’aïkido est une voie de création, non de destruction. Le respect mutuel est indispensable. L’aïkido n’est pas un combat de rue, et le tatami n’est pas un lieu de règlements de comptes : participer à une séance implique un dépassement de notre agressivité.
Puis, la pratique de l’aïkido élude complètement la compétition : une puissance incomparable puisant dans la souplesse, le contrôle de soi, la modestie, la communion avec ses partenaires remplace la force musculaire.
Chacun doit veiller à protéger l’intégrité (physique et/ou psychique) de soi-même et de ses partenaires.
Enfin, à la fin de la séance, il est de coutume de saluer et remercier le dernier partenaire avec lequel nous avons travaillé.
Dans notre relation au dojo de l’Aïkido Quimper, il est souvent question de Reishiki, l’étiquette.
Comme pour l’apprentissage des techniques, le reishiki s’apprend, mais va bien au-delà de simples gestes...
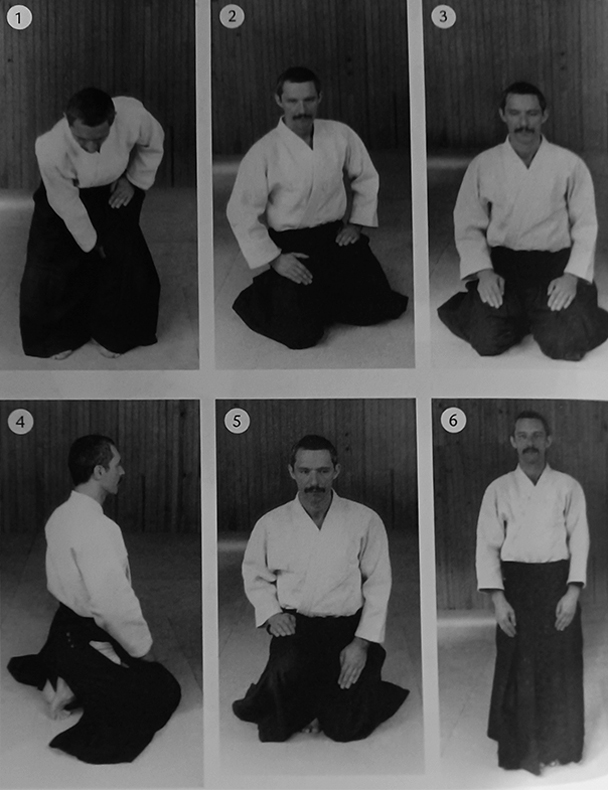
L'ukemi
la chute en Aïkido
la chute en Aïkido
Une différence de conception
Ukemi est un terme japonais composé de deux mots, uke de ukeru, recevoir, et mi, le corps. En Aïkido l'ukemi désigne la chute de celui qui reçoit la technique. Malheureusement je crois que la chute est mal comprise et considérée par la plupart des pratiquants occidentaux. Je vais tenter ici de clarifier ce concept et montrer son importance dans la pratique martiale.
En occident la chute est généralement considérée par les pratiquants comme un signe de défaite. Elle est subie comme un mal nécessaire et l'apprentissage consiste simplement à pouvoir recevoir la technique sans être blessé. C'est évidement une étape indispensable. Mais si le travail s'arrête là on aura abordé l'ukemi d'une façon totalement superficielle.
Tentative d'analyse historique
Historiquement on peut supposer que des personnes ayant subi ou vu des projections lors de luttes ou batailles ont cherché un moyen de limiter l'impact de telles techniques. Il est aussi probable que l'observation de la nature et particulièrement des animaux a été une source d'inspiration dans le processus de création des techniques de chutes.
En Occident le rapport à la chute, et donc à la pratique elle-même, est différent. Bien sûr les techniques de lutte au corps à corps se sont développées en Occident comme en Asie. Mais à ma connaissance les techniques de lutte occidentale n'ont pas développé de dégagement par la chute. Je crois que cela est dû au fait que dans cette discipline les deux combattants luttent pour la victoire dans une épreuve de type sportif. Dans ce contexte il est évidemment inutile de s'entraîner à perdre.
Bien sûr les combattants japonais cherchaient aussi la victoire. La différence est que les lutteurs occidentaux se rencontraient dans des matchs sportifs tandis que les samouraïs pratiquaient la lutte afin de pouvoir survivre sur le champ de bataille. Il leur était d'ailleurs formellement interdit de participer à des compétitions de type Sumo qui étaient réservées aux paysans et lutteurs professionnels. Dans le contexte de la guerre le seul objectif est la survie. Dans ces conditions la retraite ou la fuite font partie des tactiques évidentes et c'est donc naturellement qu'elles se sont traduites en techniques concrètes. Le travail de l'ukemi permet ainsi de s'échapper d'une technique, de la contrer, ou d'en annuler ou atténuer les effets.

Dans une projection où l'on tombe vers l'arrière, le principal danger se situe au niveau de la tête. Un choc à cet endroit pouvant provoquer une perte de conscience synonyme de défaite et probablement de mort, la chute arrière, ushiro ukemi, sert principalement à protéger cette partie.
La chute avant, mae ukemi, offre plus de possibilités de fuite ou dégagement que la chute arrière. Techniquement il s'agit de l'opposé exact d'ushiro ukemi. Une des principales erreurs tient à l'angle du corps. Alors que dans la chute arrière la position de la tête crée naturellement l'angle juste, la chute avant est souvent effectuée comme une roulade de type gymnique grâce à l'impulsion de départ. C'est une erreur fondamentale pour plusieurs raisons.
Tout d'abord il faut comprendre le contexte. La chute se produit dans une situation de combat. Le combat se faisant normalement armé il est tout à fait possible que vous ayez encore votre arme ou celle de l'adversaire que vous avez réussi à désarmer à la main. Il est alors souhaitable de la garder malgré la chute. Garder l'équilibre du corps grâce à une seule main nécessite donc de chuter en diagonale.
Par ailleurs la chute en diagonale permet aussi de limiter le contact de la colonne vertébrale avec le sol, la préservant de chocs répétés qui ont une influence néfaste pour la santé.
Enfin, la chute en diagonale crée une spirale qui nous permet d'accélérer notre vitesse pendant la chute, chose beaucoup plus difficile lorsqu'on rentre en ligne droite en faisant un cercle.
De l'importance de la chute dans l'apprentissage
L'apprentissage des arts martiaux japonais se fait par le corps, la sensation. Les explications théoriques sont rares et d'importance limitée. Le contact avec le maître revêt alors une importance primordiale. Généralement les maîtres ayant beaucoup d'élèves, les rares moments où il vous corrige sont donc des instants privilégiés indispensables à votre progression. On comprend alors grâce à la sensation éprouvée dans le corps la source d'efficacité de la technique.
Au départ l'apprentissage de la forme de l'ukemi vous évite les blessures graves. Cependant les chutes restent difficiles et provoquent toujours des chocs. Le maître vous corrige occasionnellement. Petit à petit vous apprenez à chuter dans le temps. Les chocs sont mieux absorbés et le maître peut commencer à vous choisir pour démontrer une technique. Les années passent et vous apprenez à vous harmoniser à votre partenaire. Vous parvenez à diffuser sa force et cela lui permet de travailler avec plus d'intensité. A présent le maître vous désigne régulièrement pour ses démonstrations et vous multipliez les occasions de recevoir un enseignement direct.
Enfin vous dépassez le niveau de l'harmonisation. Vous devenez capable de lire la technique du maître instantanément sans processus conscient. Vous pouvez alors attaquer avec un engagement total. Le maître peut déployer sa puissance et sa vitesse maximale, il démontre la technique dans sa forme la plus pure. Vous êtes l'un des meilleurs élèves et un des partenaires privilégiés.
L'apprentissage de l'ukemi est autant spirituel que physique. Vous apprenez à vous oublier en même temps que vous assouplissez vos os, vos muscles et vos tendons. Finalement vous dépassez la peur et n'anticipez pas dans la crainte. Votre corps réagit instinctivement et trouve spontanément le geste juste. Vous avez acquis la capacité de lire la technique de votre adversaire et de vous y harmoniser, vous permettant dès lors de la rendre inefficace et surtout de la contrer ou l'anticiper vous garantissant ainsi la victoire. Vous êtes dès lors un des représentants désignés pour relever les défis lancés contre l'école.
Méthodes de travail
Bien entendu les ukemi se développent par la pratique avec un partenaire. Mais un élément fondamental de leur étude reste la pratique solitaire de séries de chutes enchaînées. En utilisant les lignes séparant les tatamis vous pouvez petit à petit corriger votre angle, en essayant de chuter par-dessus le plus grand nombre de tatamis ou sur un seul voire un demi vous apprenez à contrôler la distance. Par la répétition vous travaillez le relâchement et le contrôle de votre centre de gravité. Au final ce travail vous permet de chuter à n'importe quelle vitesse dans n'importe quelle direction et sur n'importe quelle distance. Au plus haut niveau vous aurez appris à contrôler le poids de votre corps, développant la capacité à vous rendre aussi souple ou léger que vous le désirez.
L'apprentissage des ukemi est un élément fondamental de l'apprentissage des Budo. Cette étude si bénéfique est pourtant souvent survolée en occident car elle est sans doute trop liée à l'idée de défaite alors qu'elle recèle en réalité la source de la victoire.
Au plus haut niveau de pratique la distinction entre tori et uke n'existe plus, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. La technique seule reste dans sa pureté la plus profonde. Il n'y a plus deux personnes faisant de l'Aïkido. L'Aïkido s'exprime sans limites.
Dans notre pratique martiale à l’Aïkido Quimper, les ukemi sont travaillés régulièrement pour permettre, notamment aux débutants, d’appréhender les chutes sans crainte et ainsi développer le relâchement et la souplesse dans ces mouvements. Ce texte devrait éclaircir votre compréhension des ukemi et vous encourager à affiner vos techniques de chutes.
Le jô
histoire et technique
histoire et technique
Le jô est une arme traditionnelle japonaise, c’est un bâton moyen cylindrique de 128 cm de long, d’un diamètre de 2,6 cm et de 400 à 900 gr. Il se différencie du bâton long (bô), du bâton court (tanbô) et du demi-bâton (hanbô). Il est utilisé lors de la pratique du jodo, jo-jutsu, kobujo et aïkido.
Nous le pratiquons régulièrement à l’Aïkido Quimper.
Le jô est employé en aïki-jô, élément de l’aïkido, soit dans le cadre du désarmement à mains nues d’un attaquant armé d’un jô, soit dans le cadre de katas seul ou à deux pratiquants maniant chacun un jô.
Le jô est une arme plus récente (17è siècle) que le bokken (14è siècle) et créée par l'escrimeur Muso Gonnosuke qui, après avoir été vaincu par le meilleur escrimeur japonais Miyamoto Musashi en duel, cherchait une arme suffisamment longue pour avoir un avantage d'allonge significatif sur le sabre, mais suffisamment court pour rester plus maniable que les longues armes (lance ou hallebarde). Résultat ? Avec le jô, il a vaincu Musashi (armé de son daisho) dans le second duel. Donc, c'est une arme simple et rudimentaire mais redoutable dans des mains expertes. Aujourd'hui, il est toujours utilisé par certaines forces de police japonaises.

Le maniement du jô est caractérisé par le glissement continu des 2 mains sur toute la longueur du bâton pour pousser, tourner le jô ou pour placer les mains pour obtenir le levier le plus efficace. Ce sont autant d'exercices qui permettent de développer la coordination et le centrage de la gestuelle propre à l'Aïkido, origine d'une véritable efficacité.
Comme pour le bokken, plusieurs modes de travail sont exercés avec le jô :
Jô nage :
c'est le tori qui tient le Jô. Il sollicite uke à saisir le Jô et dès que l'uke saisit le Jô, il exécute des techniques pour le projeter et/ou l'immobiliser.
Jô dori :
c'est uke qui engage une attaque avec le Jô, et tori exécute une technique à mains nues.
Suburi :
mouvements de base, pratiqués seuls, qui permettent l’entraînement aux techniques du Jô.
Kata :
réalisé individuellement sous forme d'enchaînements simples regroupant différentes manipulations de base du Jô et permettant d'exercer son habileté gestuelle.
Awase :
travail entre uke et tori, représentant des situations d'affrontement. L'étude peut se faire Jô tai Jô (Jô contre Jô) ou Ken tai Jô (Bokken contre Jô, le Bokken étant généralement utilisé par uke pour procéder à l'attaque).
Kumijô :
ce sont des katas (situation où les techniques utilisées par uke et tori sont codifiées), réalisés Jô tai Jô, avec un ou des partenaires dans des phases de simulation de combat.
Les différences entre le jô et le bokken
On constate souvent qu’une majorité de pratiquants a une affinité particulière pour le jô. L’arme semble facile à manipuler, elle glisse dans la main et offre de multiples possibilités. À ce titre, n’oublions pas que quand on peut tout faire, ou presque, on finit souvent par faire n’importe quoi. Par ailleurs, au contraire du ken, le jô représente un certain potentiel applicatif : aujourd’hui, on a plus de chance d’avoir à utiliser un bâton pour se défendre qu’un sabre…
Différence de forme, différence de manipulation.
En Aïkido, on utilise principalement le jô pour effectuer des tsukis (coups d’estoc). C’est pédagogiquement aisé à mettre en place. Toutefois, il ne faut pas oublier que le jô peut « couper » (à proprement parler il s’agit d’une frappe ayant la trajectoire d’une coupe) avec sa « lame », terme définissant les arêtes à chacune de ses extrémités.
A l’Aïkido Quimper, le jô est un outil pédagogique qui permet de découvrir les notions de distance, de placement et de travailler les techniques sous une autre forme.
Le hakama
origine et symbolique
origine et symbolique
Le hakama est un type de vêtement traditionnel japonais. C'est un pantalon large plissé (sept plis, cinq devant et deux derrière), muni d'un dosseret rigide (koshi ita). Il était traditionnellement porté par les nobles du Japon médiéval, et notamment les samouraïs. Il prend sa forme actuelle durant la période Edo. De nos jours, le hakama est porté par les hommes et par les femmes.
Le hakama est premièrement utilisé par la cour impériale chinoise sous les dynasties Sui et Tang. Par la suite, les nobles Japonais adoptent ce vêtement au 6è siècle. Les hakamas japonais sont portés par-dessus un kimono (hakama-shita), sont noués à la taille et tombent sur les chevilles. Depuis le 14è siècle, ils ne sont portés que par les hommes.
Depuis le 12è siècle et jusqu'à la fin de la période Edo, la tenue des samouraïs inclut un hakama.
Certains prétendent qu'un des rôles du hakama était de masquer les mouvements des pieds, pour mieux surprendre l'adversaire. Cette explication ne fait pas l'unanimité : en effet, les samouraïs portaient des jambières qui demeuraient visibles sous le tissu. Par ailleurs, lorsqu'il n'était pas en armure mais se préparait à un combat, le samouraï remontait le hakama en le coinçant au niveau de la ceinture, de même qu'il attachait les manches du kimono par une bande de tissu, le tasuki. C'était en fait essentiellement un pantalon de cavalerie, hakama umanori, mais il existe des hakamas dont les jambes ne sont pas séparées (andon bakama).
De nos jours, le très ample hakama est utilisé dans certains arts martiaux comme l'aïkido, le kendo, le kinomichi, le iaido, le kenjutsu, l’aïkijutsu, l’aïkibudo, le ju jitsu, le nihon kempo, le shinkendo, le naginatajutsu et plus rarement le judo. Pour le ju jitsu, il est utilisé dans les koryū (écoles anciennes) principalement, et non dans les styles modernes.
Dans ce contexte, on parle parfois de keikobakama (littéralement « hakama d'entraînement »). Les hakama utilisés pour les arts martiaux sont en coton, en soie ou, le plus souvent, en polyester ou dans un mélange de ces trois fibres. Le coton est plus lourd, tandis que les fibres synthétiques glissent mieux sur le sol et résistent mieux à la décoloration, ce qui peut être important pour les arts martiaux comme le iaido ou l'aïkido.
Le hakama est également un vêtement de cérémonie (mariage, remise de diplôme, etc.). Les femmes portent des hakama assortis à leurs kimonos, de couleurs vives ou à motifs, tandis que les hakama masculins sont le plus souvent à rayures. Le hakama de cérémonie étant en soie, cela en fait un vêtement fragile, onéreux et d'un entretien difficile.

Selon certaines légendes, les sept plis représentent les sept vertus que doit posséder le samouraï : jin ( bienveillance, générosité ), gi ( honneur, justice ), rei ( courtoisie, étiquette ), chi ( sagesse, intelligence ), shin ( sincérité ), chu ( loyauté ) et kō ( piété ). D'autres sources parlent plutôt des termes yuki ( courage, valeur, bravoure ), makoto ( sincérité, honnêteté, réalité ), meiyo ( honneur, crédit, gloire) 3. Cette symbolique n'est pas clairement établie et son origine ne dispose d'aucune source fiable.
En Europe, le hakama est surtout porté par les pratiquants d'arts martiaux. Dans certains d'entre eux (kyudo, kendo, iaido, aïkibudo), il fait partie de la tenue obligatoire. Dans d'autres, en particulier l'aïkido, aïkibudo ou l’aïkijutsu, il peut être porté lorsque l'élève a atteint un niveau technique lui permettant de gérer la gêne qu'occasionne le port du hakama ; la décision d'autoriser un élève à le porter est laissée à la discrétion de l'enseignant, il est devenu de fait un signe d'investissement personnel dans la discipline et de niveau technique, bien que cela ne soit pas son sens originel.
Pour la pratique martiale, le hakama se noue en commençant par la partie avant. Le sommet de celle-ci doit dépasser la ceinture (kakuobi) de quelques centimètres. La longueur des lanières diffère suivant la discipline : égales pour l'aïkido, courtes à l'arrière pour le iaido. Les lanières avant sont alors passées autour de la taille juste au-dessus de la ceinture, croisées derrière et reviennent sous la ceinture (obi), où elles sont nouées à l'aide d'un nœud simple. On met alors en place la partie arrière, le dosseret au creux des reins. Les lanières arrières se positionnent sur la ceinture (obi) ou au-dessous, et viennent se nouer sur l'avant avec un nœud similaire à celui de la ceinture et englobant les deux brins avant. Les manières de ranger les lanières divergent selon les écoles.
Le Hakama, un simple vêtement ?
Par-delà le “simple” vêtement complémentaire aux équipements pour la pratique de l’Aïkido, il symbolise néanmoins ce que les traditions inter-générationnelles ont perpétré. Il représente ainsi la nature du Bushidō.
De nos jours, porter le hakama permet au pratiquant de s’immerger dans la pratique martiale tout en intégrant une posture honorable. Car il décrit notre propre vie par notre façon personnelle de le revêtir, de le porter, de le plier, de l’entretenir, de le ranger.
Tout pratiquant est responsable par son comportement de la réputation de son école (Ryu). Son avancée est symbolisée par sa ceinture et son hakama. Ainsi, son grade représente l’ensemble indissociable d’une triple valeur morale, technique et physique. C’est pourquoi, O’Sensei rappelait que les pratiquants d’Arts Martiaux se doivent de “polir les sept vertus du Budō, reflets de la vraie nature du Bushidō, que les sept plis du Hakama symbolisent” :
7 plis pour les 7 vertus du Budō
Gi (honneur, justice) :
Le sens de l’honneur passe par le respect de soi-même, d’autrui, et des règles morales que l’on considère comme justes. C’est être fidèle à ses engagements, à sa parole, et à l’idéal que l’on s’est choisi.
Rei (courtoisie, étiquette) :
La politesse n’est que l’expression de l’intérêt sincère et authentique porté à autrui. Quelle que soit sa position sociale, au travers de gestes et d’attitudes pleins de respect et de sollicitude.
Chi (sagesse, intelligence) :
La sagesse est l’aptitude à discerner en tous lieux et en toutes choses, le positif et le négatif. A n’accorder aux choses et aux événements que l’importance qu’ils ont, sans se laisser aveugler ni se départir de la sérénité si durement acquise sur le tatami.
Shin (sincérité) :
La sincérité est impérative dans l’engagement martial. C’est pourquoi, sans elle, la pratique n’est que simulation et mensonge, tant pour soi-même que pour autrui ; l’engagement se doit d’être total, permanent, sans équivoque. La sincérité se constate facilement et l’illusion ne peut perdurer longtemps devant les exigences et le réalisme de la Voie (dō).
Chu (loyauté) :
Il peut paraître désuet de parler de Loyauté et de Fidélité dans notre société contemporaine alors même que ces valeurs sont le ciment indéfectible de nos disciplines martiales. L’Aïkidoka s’engage, comme le Samouraï envers son Daimyo, à une fidélité totale mais surtout à un respect loyal des règles internes à son École. De même que ces valeurs sont le reflet de la rectitude du corps et de l’esprit du pratiquant.
Koh (Piété) :
La piété s’entend ici dans le sens de respect profond et authentique des bases de nos pratiques martiales. (techniques, spirituelles, historiques, philosophiques…) .
Jin (bienveillance, générosité) :
La bonté ou la bienveillance suppose une attitude pleine d’attention pour autrui. Celle-ci doit être sans considération d’origine, d’âge, de sexe, d’opinion ou de handicap. Mais encore, le respect permanent des autres avec le souci de les honorer sans jamais leur causer de troubles ou de peines inutiles. Nous retrouvons ici le Bushi No Nasake, la sympathie ou la clémence du guerrier nippon. Celui-ci pouvait certes trancher de son sabre tout problème lui étant soumis. Mais il possédait également la possibilité de pacifier les esprits sans ôter la vie.

Le rangement comme le pliage du hakama répond à tout un rituel et il peut varier selon les personnes et les écoles mais on retrouve en général l'ordre ci-après.
La tresse
Les lanières sont pliées en réalisant une tresse. Une fois le hakama plié, on déploie les lanières de chaque côté.
Étape 1 : on replie la lanière inférieure droite sur elle-même en travers du hakama.
Étape 2 : on fait de même avec l'autre lanière inférieure.
Étape 3 : la lanière supérieure gauche passe sous les deux lanières pour ressortir vers le haut.
Étape 4 : elle entoure ensuite la partie supérieure de la lanière gauche.
Étape 5 : elle se pose sur la partie inférieure de la lanière droite.
Étape 6 : la lanière droite passe sous les trois autres pour ressortir vers le haut.
Étape 7 : elle enserre ensuite la partie supérieure de la lanière droite.
Étape 8 : elle vient enfin se poser sur la partie inférieure de la lanière droite en passant par la boucle formée par la lanière supérieure gauche.
Quel Hakama pour la pratique de l’Aïkido ?
Pour la pratique de l’Aïkido, le choix de la qualité du hakama résidera dans la qualité du textile utilisé. En effet la matière (coton, synthétique etc.) pourra influencer la fluidité de la pratique, notamment lors du travail au sol. Il existes ainsi quelques marques comme Tozando, ou Iwata, renommées pour la qualité de leurs Hakamas.


